|
|
| La cicatrice Retour sur l'origine, retrouver la trace, le trou ensanglanté d'où nous sortons tous. Une affaire de baise, de sang. L'image originelle à la fois la plus sociale, et la plus intime. Ainsi, dans les dix-sept crayonnés que Ungerer réalise au moment des célébrations du Bicentenaire, il en est trois qui forment une famille à part, les seuls qui reprennent en gros plan la tête d'un homme décapité, Robespierre, Danton, Marat. Des hommes mûrs, terribles et imposants, des figures qui expliquent peut-être pourquoi Jean-Auguste Dominique Ingres, cet autre peintre des gris qui se prennent pour des rouges (un dispositif graphique typique de la série consacrée à la Révolution) est cité par Ungerer comme étant son peintre préféré. Un peintre qui détonne parmi la famille expressionniste, Grunewald, Dürer, Schongauer, Jérôme Bosch, Goya, qu'il citait jusque là... Ingres, le plus oedipiens de tous les peintres classiques, qui peint la figure du père sous les traits d'un Jupiter colossal - "Jupiter et Tétis", au musée Granet d'Aix. Un père idéalisé mais absent chez Ungerer, puisque décédé, ce qui explique bien des choses. Comment voulez-vous que le gamin eût intériorisé ce concept de Loi, de cadre, de limite, depuis la cave où il assiste au spectacle de la vraie guerre comme on regarde un livre d'images ? Jo, le petit chat de Pas de baisers pour maman avait un père pour lui indiquer les bornes à ne pas dépasser. Pas Tomi. Avec Ungerer on ne quitte jamais le cirque, ou le Music-hall, avec cette fois le numéro de la femme coupée en deux. "Mon père était à la tête d'une entreprise familiale d'horloges d'églises, de carillons, et d'horloges astronomiques. En dépit de sa mort lorsque j'avais seulement trois ans, il m'a laissé une forte impression. Il était ingénieur, historien, un astronome et un artiste accompli" (7). Tomi sera tout aussi curieux, mais comme la guerre est passée par là avec son cortège de morts et de destructions, il faudra bien intégrer ces nouvelles données. Le hublot est identique, qu'il s'agisse de la découpe du ventre de la belle ou de la prothèse oculaire. Complexité du problème à résoudre par un petit horloger à la fois dépeceur et réparateur : la mort du père, l'enfance, la guerre, le jeu, le bricolage, l'érotisme (car la demi femme dont on ne sait s'il elle est vivante ou mécanique prend du plaisir à se faire ainsi tripoter), les relations privées de dominance ou de dépendance, les relations sociales, le métier, le plaisir, etc. Toujours se rappeler le mot d'André Malraux, selon lequel on aurait beau réduire la Vénus de Milo en mille morceaux, on n'en trouverait nulle part le secret. Ungerer a choisi de se vider les tripes. Violence que de tout sortir, tout déballer, exposer ce que d'habitude on cache si bien, tant pis si cela choque. Il confie à François Mathey, en postface de Testament : 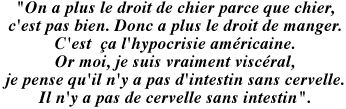 Il faut pouvoir cracher ses pensées, mieux encore les vomir. Penser et vomir, aux deux bouts du corps. Écart optimal. Mettre ensemble, mais sans les mélanger, les choses les plus opposées. Pratiquer l'écart afin que jamais la cicatrice ne se referme. Chez Ungerer le noir et le blanc cohabitent, sans jamais se mélanger en gris. Ce thème du privé traversé par le social féconde la création chez Tomi Ungerer. Il tourne la question dans tous les sens, revenant sans cesse sur la micro-organisation privée (je suis un corps, un coeur, des émotions, une mémoire tout à fait individuelle. Je suis Un), ayant à trouver sa place dans la macro-organisation sociale (Nous sommes six milliards). Le local et le global. Un rapport de force pareil à celui des enfants qui s'imaginent que les adultes ont tous les pouvoirs, raison pour laquelle sans doute Ungerer s'implique tellement dans la littérature destinée aux enfants. Le petit, dans sa sphère individuelle, contre les grands, uniformes. On reproche souvent à Ungerer sa violence, à quoi il répond qu'elle est le cadre dans lequel il a appris à vivre, et qui depuis ne change pas vraiment. Dès lors, pour nous simplifier la vie, nous choisissons le plus souvent de porter un masque. Une seconde peau qui nous colle à la peau et que Ungerer s'ingénie à arracher. 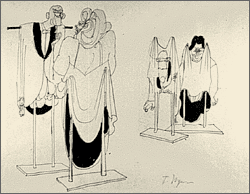 C'est dans le livre The party en 1966 qu'il livrerait ses dessins les plus cruels, dont celui-ci, une galerie de portraits les plus écoeurants les uns que les autres. Une galerie de monstres, qui se pavaneraient dans les plus beaux salons new yorkais en mangeant des petits fours. Un autre cirque. Ils sont au faîte de la pyramide sociale, riches s'entend, mais dans quel état ! Ungerer dessine leur décrépitude qui n'est pas seulement physique, mais on le devine, morale. "Ce que j'expose, ce sont souvent les éléments du mal dans la société, sur un plan tout à fait moral. Enfin, j'ai mon éthique à moi, mon système moral auquel je tiens très fort" (8). Ces gens trichent, et Zorro le dessinateur, Tomi Ungerer, les montre tels qu'ils sont. Bien entendu, ayant appris dans notre jeunesse la parabole de la paille et de la poutre, il faut avoir l'humilité de reconnaître que ceci nous concerne aussi. Pour beaucoup, The party est considéré comme son livre le plus iconoclaste. Iconoclaste, briseur d'image, expression qu'il faut entendre dans le double sens littéral et métaphorique. Iconoclaste, sachant que dans notre culture des médias, l'image vaut plus que la réalité. Un mot du dessin, pour signaler que la grande tradition du portrait, qui va de Holbein à Ingres, induit toujours le respect du modèle en montrant la durée nécessaire à réaliser ledit portrait. Ungerer en prend le contre-pied, dans un dessin que l'on dirait bâclé s'il ne se montrait d'une précision d'horloger. Aucun enfant ne pourrait dessiner de la sorte, alors qu'il ne s'agit, à première vue, que de brouillons. Le portrait classique implique la déférence, la révérence d'un métier lisse. Le gommage des bosses et des trous. Un métier poli, à comprendre dans les deux sens physique et d'éducation. 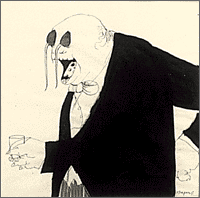 1966 |
|
On ne peut demander au vitriol d'être de l'eau douce "Je garde de l'époque où j'avais dix-huit ans une image monstrueuse. J'étais en colère. Et je suis de nature à exagérer les choses. Cette colère, elle m'a poursuivi. L'un de mes soucis a été de la dominer, de la comprendre" (9). 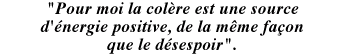 |
||
| (10) |
||
"Colère de n'avoir pas eu de père, colère d'avoir été trop aimé... Je passe ma vie à caresser ma colère qui pour moi n'est pas un péché capital mais capiteux" "J'ai souffert toute ma vie à la vue de la guerre, à la vue des injustices, et je suis assez
casseur, je me lance constamment dans les bagarres. Quand je dessine... c'est la barricade... et trois semaines après, il y a la circulation qui passe dans les rues. La barricade est oubliée" (11). La réussite d'un tel dessin tient en un dispositif tout simple, qui fit en son temps le renom d'Archimboldo par exemple, qui donne une image d'ensemble tout à fait crédible (on cligne les yeux et tout est normal) ; alors que la précision des détails raconte une autre histoire (les rats, le fromage). Différence du loin et du près, ou une fois encore de la méga-machine d'ensemble et de la micro-machine des particularités.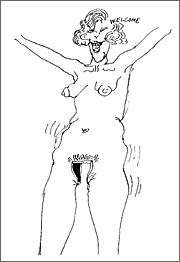 Le cirque toujours, et le sourire de chaque artiste commençant et terminant son numéro. "Welcome" dit la belle. Le même dispositif s'y exerce que dans "l'homme aux rats", à savoir une image d'ensemble que rien ne dérange (par exemple la tache noire de la touffe pubienne), mais avec un détail qui détraque la machine. Un détail d'importance il est vrai, qui ne peut échapper aux hormones à l'affût en chacun de nous. Cette femme qui se trémousse et nous invite dit également l'artificialité de son corps, comme une coquille vide. Plutôt, un corps en deux moitiés, le haut pour dire le vivant, et le bas pour dire l'artifice. Pour peu, on dirait une poupée Barbie, à ceci près que la Barbie est belle comme une madone de Botticelli. Ungerer s'emporte à propos de Barbie qu'il décrit comme "Une anatomie sans orifice, parce que le puritanisme américain nous gratifie de sa vision du monde où tout ce qui est orifice est péché" (12). 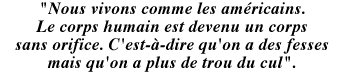 |
||
| (13) |
||
| Les orifices, que dans certains cas on a vu bouchés par des rats, ou ici tellement grands ouverts qu'ils en deviennent vides, absurdes. Une cervelle, sans intestins. Non, dit Ungerer, pas de compromis avec la morale américaine qui cache ce trou qu'elle ne saurait voir. Je leur en fait voir, en grand format. Multiplions donc les dessins, les orifices et les plaisirs qui font sourire. Deux anecdotes sont à relier à la série de dessins tirés de Fornicon : lors d'une convention du livre d'enfant, au début des années soixante-dix, Ungerer fut interpellé en ce mots : "quelqu'un qui fait un livre comme "Fornicon", n'a pas le droit de faire des livres pour enfants". A quoi Ungerer répondit du tac au tac : "Écoutez mon vieux, si les gens ne baisaient pas ils n'auraient pas d'enfants. Et on en aurait rien à foutre de tes simagrées et de tes livres minables" (14). Une autre : convié à la réception d'un prix gagné par un de ses livres pour enfants, on rapporte que l'on demanda à Ungerer "s'il était vrai qu'en marge de ses productions dans le secteur, euh, il aurait, euh, disons, des productions plus... légères..." A quoi Ungerer répondit au grand émoi de son auditoire : "Il n'y a que deux façons de faire du fric, les enfants et le cul". Dont acte. Ceci dit, la provocation de Fornicon semble résider dans le fait que la sexualité s'y développe de manière solitaire, heurtant un gigantesque tabou des années soixante. Ungerer y montre une sexualité de pure sensation, dégagée de tout affect, le plaisir des orifices. Ungerer se souvient de son censeur au lycée lui disant "Ungerer vous êtes un fumiste !" |
||
| (15) |
||
| Il raconte encore comment à la fin de son parcours scolaire, le commentaire de ses études se résumait à "Pervers et subversif" (16). Deux mots qui retiennent l'attention, par leur étymologie d'abord, parce qu'ils
proviennent de "vetere", signifiant tourner, puis retourner, renverser, etc, affirmant dans le champ linguistique ce que l'on observait tout à l'heure dans les révolutions graphiques. "Pervers", qui selon "le Petit Robert" signifie "enclin au mal... effet pervers, détourné de sa fin... déviation des instincts élémentaires... actes immoraux et antisociaux". "Subversif", selon la même référence signifie "renverse l'ordre établi... susceptible de menacer les valeurs reçues". Ceci explique peut-être pourquoi Ungerer ambitionne de faire des livres destinés aux enfants, mais qui ne plaisent pas aux parents. Quant à la psychanalyse, elle est certes autorisée à donner son avis, dans la mesure où Ungerer lui-même ne rencontre aucune gêne à la provoquer. Quoique à ma connaissance ce travail n'a pas (encore) été fait, tout le monde ne pouvant être de son vivant Léonard de Vinci ou Van Gogh ! Elle dit que le plus grave danger que court chaque individu serait de ne pouvoir atteindre le stade génital (le dernier), et de rester fixé à l'un des stades antérieurs ou d'y régresser. La régression fabrique la perversion. C'est pourquoi l'enfant est nommé "pervers polymorphe", qui contient en germe toutes les perversions de l'adulte : exhibitionnisme, voyeurisme, sadisme, masochisme, etc. Il est assez clair que Ungerer trempe dans tout cela à la fois, à cette nuance près qu'il comprend très vite qu'il s'agit de dépasser les balises du triangle familial pour affronter le social dans toute sa complexité. Si Ungerer peut à la fois écrire et dessiner pour les gosses, réussir des affiches, créer un des posters les plus efficaces contre la guerre du Vietnam, se réjouir de satire sociale, jouir de dessins érotiques, être brillant dans chacun de ces domaines et en tirer de quoi vivre honorablement, c'est que les fantasmes appartiennent à des groupes, davantage qu'à des individus. Une seconde intuition de Ungerer, toute simple, visualise l'idée selon laquelle les choses ne commencent pas avec l'enfant, ou pour reprendre la formule deleuzienne "le père oedipianise le fils". Enfin, il faut sans doute moins voir dans les ciseaux une image de la castration, que celle deux pièces d'une même machine, qui coupe et qui connecte, dans ce que les flux ont de transitoire et de local, chaque pièce pouvant à tout moment divorcer de son contrat, et reprendre son indépendance pour s'en aller, tout aussi temporairement et localement se brancher sur une autre, etc. Et l'enfant dans tout cela ? A lui, comme déjà dans la série des "Mellops", de bricoler ses petites machines à partir de ce qu'il trouve. Il lui faut passer d'un monde de la reproduction au monde de la production. On arrive ainsi aux quelques images tout terrain parce qu'elles ne sont jamais relatives à un moment, à une situation, à une relation précise. Intemporelles en quelque sorte. Elles disent l'angoisse, le désespoir, la peur. L'homme, dont on ne voit pas le visage et habillé comme pour se protéger de la pluie, chapeau, gants, trop petit pour le poids des misères qu'il transporte, et qu'il ne connaît même pas, et dont l'agitation sera toujours vaine. "J'ai peur... je suis né avec la peur, et c'est une "belle" malheur. Quand on est désespéré, on peut comprendre le désespoir des autres et le désespoir des situations en sachant très bien qu'on ne peut rien y changer - mes livres ne peuvent rien y changer, mes dessins ne peuvent rien y changer. Mais ça peut faire, peut-être, une toute petite différence et c'est la raison pour laquelle il faut continuer" (17). Du point de vue de l'efficacité graphique, il faut noter l'ombre qui fait comme si le personnage était dans le champ d'un projecteur ou d'un violent soleil, alors que la situation requerrait probablement une mise à l'ombre. Reste l'angoisse. La peur a un objet, pas l'angoisse. Une ombre, votre propre ombre, une tache noire qui vous saisit par derrière et vous étouffe. Une ombre grande comme un adulte, et vous petit comme un enfant. Vous hurlez, pas un son ne sort de votre gorge. Vous engendrez votre propre malheur, que vous ne pouvez voir. Vous êtes surpris. Non seulement l'ombre se met à vivre, ce qui est déjà terrifiant, mais en plus elle se retourne contre vous. L'ombre se métamorphose et désobéit trois fois, d'abord en prenant vie, puis en acquérant suffisamment de matérialité pour étrangler son maître ; ensuite en ignorant la posture du modèle, jusqu'aux coudes qui montrent que l'on a affaire à un squelette alors que le modèle est plutôt petit, et gros. Astuce de dessinateur, les mains de l'ombre qui serrent la gorge sont du même tracé que le contour du bras gauche du petit bonhomme, que l'arrière de son dos, ses jambes, histoire de parfaire la révolution d'un dessin qui fait boucle. Il n'y a que les dessinateurs pour savoir que l'on ne se méfie jamais assez du dessin. |
|
Les métamorphoses du dessin Chercher l'écart le plus grand, comme dans les photomontages, photographies dont Ungerer détourne le sens initial par l'ajout de quelques lignes judicieusement tracées. Les choses ne sont pas ce qu'elles sont, un rien suffit pour qu'elles deviennent autre. Il n'y a pas de vérité, la révolution du sens se joue sur un détail. 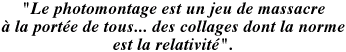 |
||
| (18) |
||
| Quoiqu'en dise Ungerer, il y a massacre, mais aussi réflexion sur le médium utilisé, parce que le dessin permet à l'imagination de passer au visible. Quelques uns de ses dessins (mais évidemment il n'est pas le seul, ce serait même le propre de tous les grands dessinateurs) travaillent ce processus de façon tout à fait explicite. Ainsi cet entomologiste, portant lunettes et
une loupe en main, comme pour mieux y voir. Or, le scorpion qu'il regarde se métamorphose en papillon. Est-ce un phénomène de perception ou d'imagination ? Le dessin ressort-il de la
reproduction ou de la production ? Sans doute, dans le cas de Ungerer, des deux à la fois. Importance de la métamorphose pour les dessinateurs (pour les raconteurs), tout à fait fondamentale
parce qu'elle est le processus de création, ni plus, ni moins. Sans événement il n'y a pas de vie. L'imprévu désobéit aux prévisions. "Expect the unexpected" disait déjà Ungerer il y a une trentaine d'années, et dans la foulée, "Probe the improbable". Il y a saut de plan, et ce saut, est la
création. Exactement comme en biologie ou en génétique où on l'appelle mutation. La mutation permet l'Histoire et les histoires. Elle est le facteur de différence entre un modèle et sa copie. L'intuition de Ungerer dit aussi que, lorsque le scorpion devient papillon, il devient également corps de femme nue, indiquant par là que les mutations, les récits, sont intimement liés au désir. Dit autrement, le désir social de taxinomie rencontre le besoin individuel de se reproduire. Les hormones dont nous n'avons pas conscience nous gouvernent, tout autant que la raison habitant nos lobes cérébraux. Que dire alors d'une dame dont les pieds laissent sur le sol les empreintes d'une chatte ? L'image allume des fantasmes, certes, tandis sur le plan d'une réflexion sur le dessin, cet événement pose la question de la croyance : qui croire, du dessin (de l'illusion) ou de la représentation ? Quelques petites taches à l'encre noire sur un papier blanc interrogent le statut des images, chez Ungerer avec davantage de violence que chez Magritte cependant. Affirmer et mettre en doute à la fois, dire une chose et son contraire, contredire nos habitudes culturelles. Croire ce que me dit le dessin, ou ce que me dit la logique ? Si une dame laisse des empreintes de fauve, elle peut tout aussi bien devenir un livre. Il suffit d'une analogie de forme. La plupart d'entre nous est incapable de concevoir ce saut créatif dans la perception, alors que nous avons pourtant déjà vu cet objet des milliers de fois. Précisément, la force de Ungerer réside dans cette attention - on pourrait dire "dressage" - à voir dans une chose, fut-elle la plus banale, son exact contraire. Pour le dire autrement, là où il y a du noir, Ungerer y voit aussi du blanc. Et inversement, de manière systématique. Il faut remarquer la qualité souvent matérielle de l'imagination de Tomi Ungerer, qui, on s'en souvient, excellait jadis dans la réalisation de sculpture en papier, ou la confection de cerfs-volants ; aujourd'hui de jouets mécaniques, de sculptures faites de récupérations, etc. Que retiré en Irlande il y vit quasi en autarcie, une vie impensable si l'on est pas doué d'un solide sens pratique. Se forcer à voir son contraire dans toute chose, et ne rien faire, que du contraire, pour réduire l'écart. On se souvient de l'écart radical que Ungerer met au centre de son dispositif de création, de la cicatrice qu'il n'entend jamais refermer. Il fait cohabiter le noir et le blanc sans que jamais leur union ne produise du gris, comme le courant électrique, qui pour exister nécessite les deux pôles positif et négatif. Le noir et le blanc, le tragique et le cirque, le présent et le passé, le dépeçage et l'analogie, la marginalité et la sociabilité, les viscères et la pensée, la provocation et l'affection, la colère, les sourires, l'égoïsme et la générosité, le désespoir et l'espoir, le local et le global, les enfants et le cul, le fric et l'art, le sexe et l'intellect, la fumisterie et la subversion, l'ogre et l'enfant, etc. Tomi Ungerer, un ogre au sourire d'enfant. Qui chercherait dans sa vie d'adulte des intensités comparables à celle de son enfance ; quoique jamais par le biais du souvenir nostalgique. Quelle image dessiner, ici et maintenant, qui dérange tout autant que lorsqu'il était petit, dans sa cave, sans son père, à visionner la violence d'un cirque qui était hélas une vraie guerre ? Vincent Baudoux enseignant à l'École de recherche graphique à Bruxelles |
| 7. 16. The poster Art of Tomi Ungerer, Diogenes Verlag AG, Zürich, 1971 |
| 8. 13. 15. 17. Testament, Diogenes Verlag AG, Zürich, 1985 |
| 9. Lectis numéro 6, Strasbourg, 1992 |
| 10. 14. Conversation avec Ungerer, Paola Vassali, Carte-Segrete, Roma, 1991 |
| 11. 18. 33 Spective, Anstett, Strasbourg, 1990 |
| 12. Polystyrène n°4, Strasbourg, 1997 |