|
|
|
L'Ogre au coeur d'enfant Conférence de Vincent Baudoux Grenoble, le 13 novembre 98 |
| Les petites bêtes à succès Nous sommes aux Etats-Unis en 1957, Tomi Ungerer publie son premier livre. The Mellops go flying marque immédiatement sa différence d'avec les productions qui l'entourent, parce qu'il met en scène une famille de petits cochons. Il faut se rappeler qu'à l'époque, la littérature à destination des enfants excluait, entre autre animal, le cochon, symbole quasi universel de goinfrerie, qui dévore et engouffre tout ce qui se présente. "Le porc prend son plaisir dans la fange et le fumier" écrivait Saint Clément d'Alexandrie, citant Héraclite. Il est mal élevé, il pue. Ne dit-on pas qu'il ne faut point jeter des perles aux pourceaux ? Bref, l'animal ne semble pas un bon modèle éducatif, d'autant que le récit présente le père et les fils Mellops s'amusant à longueur de journée, tandis que la mère au foyer les attend avec autant d'affection que de délicieux petits plats mijotés. Une distribution des rôles qui va à contresens de l'évolution des moeurs. Malgré le monde de l'éducation et les parents qui désapprouvent, le livre ravit les enfants, garçons et filles. Ils en redemandent, rassurés par un graphisme qui ne prend aucun risque, avec ses images passe-partout, un peu de ligne claire mais pas trop, un peu de faux croquis mais pas trop, un peu de détail mais pas trop, un peu de profondeur mais pas trop, un peu de perspective mais pas trop, un peu de naïveté mais pas trop, etc. L'année suivante Crictor raconte l'histoire d'un petit garçon qui offre un serpent à sa mère en guise de cadeau d'anniversaire. Comme avec les Mellops, l'auteur y joue du décalage entre la forme et le contenu, car si l'idée du serpent innove une fois encore par rapport aux productions de l'époque, le graphisme reste on ne peut plus traditionnel. Une fois de plus le succès est au rendez-vous. Bientôt il y aura Emile la pieuvre, Rufus la chauve-souris, Orlando le vautour, et pourquoi pas Joséphine, la mouche Tsé-Tsé ? Ungerer a tellement bien joué de ce décalage entre les mots et les images tout au long des nombreux livres qu'il a écrit et dessiné depuis plus de trente ans, il a tellement été suivi, et plagié, que nous avons du mal à percevoir le côté novateur qu'une telle production pouvait avoir à l'époque. Le géant de Zéralda, en 67, fait désormais partie des grands classiques de la littérature enfantine, qui raconte l'histoire d'une gamine qui remet un ogre sur le droit chemin. 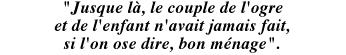 Parce que dans l'imaginaire ancestral l'ogre incarne les forces du mal, un géant qui se nourrit de la chair tendre des petits enfants. L'animalité dévorante, l'homme au couteau, les dents aiguisées, qui a toujours faim, ce que rend très bien l'image de couverture, impression renforcée par le fond noir et les couleurs rougeoyantes comme la braise. Le couple de l'homme et de la petite fille sont comme à l'intérieur de l'âtre d'une cheminée. On l'entend grogner. Elle n'a pas l'air effrayée. Au regard mauvais elle répond par un regard clair. A la gueule qui s'ouvre, elle répond par un sourire. Ainsi, Ungerer retourne comme un gant le rapport traditionnel de l'adulte à l'enfant, puisque c'est la générosité, la compétence et le sang-froid de la petite femme qui au bout du compte parvient à éduquer l'adulte. 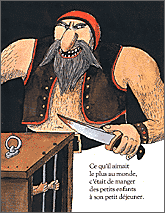 1967 En fin de récit, Zéralda rend ce méchant sociable, et même davantage. Il s'est rasé la barbe, et sourit. On ne voit plus ses dents pointues. Le monstre s'est métamorphosé en Père Noël qui distribue des friandises aux enfants. Au lieu de les manger il en fait. "Ils se marièrent, menèrent une vie agréable et eurent un grand nombre d'enfants". L'image finale montre le plus classique des clichés, le fond s'éclaircit, les couleurs gagnent en intensité et reprennent la gamme de l'arc en ciel, des roses tressent un cadre à la photo de famille. L'herbe est verte et tous mènent désormais la vie de château. Un monde idéal, à deux détails près. En effet, clore un récit par "On peut donc penser que leur vie fut heureuse jusqu'au bout", ne signifie pas du tout qu'il en sera ainsi, mais simplement qu'il s'agit de l'issue la plus probable. Or, que se passe-t-il dans le coin inférieur droit de cette image finale, sinon qu'un des enfants du couple dissimule derrière son dos un couteau et une fourchette ? Est-ce un hasard si Ungerer lui fait porter des vêtements dans la gamme des rouges, oranges, bruns que portait l'ogre de la couverture ? On peut donc penser que le naturel revenant au galop, les lois de la génétique en ont fait un ogre. il faut donc aussi penser que la vie de Zéralda et de son mari ne sera pas heureuse jusqu'au bout. Monsieur Racine découvre dans son jardin une bête étrange, "qui ressemble à un tas de vieilles couvertures, de longues oreilles flasques pendaient comme des chaussettes des deux côtés d'une tête dont on ne voyait pas les yeux". Il se prend d'affection pour elle, et passe désormais ses journées à lui offrir tous les plaisirs que pourrait souhaiter un enfant. "L'étude de l'animal ne lui trouve aucun rapport avec une forme vivante quelconque. Les tissus de son corps étaient sans vie et il n'avait pas de squelette. L'ensemble du corps paraissait être un assemblage de parties vivantes indépendantes les unes des autres". A ce stade on remarque deux choses. D'abord, l'impertinence qu'il y a à montrer ce brave Monsieur Racine... jamais loin d'un verre d'alcool ou d'une bouteille toujours entamée. Chaque image le prouve, même s'il s'agit d'un détail discrètement déposé dans un coin du dessin. Deuxièmement, les cadres sont omniprésents à l'intérieur de la maison de Monsieur Racine, et tout au long du récit Ungerer en joue, l'éprouve, le met à mal, le répare, mais toujours avec discrétion et humour. Il va falloir s'expliquer ces deux détails. Monsieur Racine décide alors de présenter sa bête à l'Académie des sciences, où ils seront reçus en grande pompe. Et là, l'imprévisible arrive : le fameux animal se révèle être une supercherie de deux enfants qui ont réussi à berner les adultes. Depuis le début ils étaient à l'intérieur du petit cheval de Troie. Décidément, même les adultes les plus sérieux sont crédules comme des enfants. Et comme des enfants ils réagissent en créant la plus grande pagaille dont on puisse rêver. Il faut regarder de près cette image et la suivante, des émeutes, qui montrent ce que d'habitude on cache (Les flics, la perruque, le pantalon, la jambe artificielle, le visage à la Picasso). Les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Chacune et chacun ose ce que les conventions sociales réprouvent, tandis que sur l'estrade, imperméable au tohu-bohu qui l'environne, toujours son verre de pinard à portée de main, Monsieur Racine continue son discours. Avec La grosse bête de Monsieur Racine, Ungerer intègre en un seul récit la plupart des ingrédients que l'on avait observé auparavant : des enfants plus malins que les adultes, le triomphe des affects, l'ambiguïté de la chute, une marginalité qui finit bien. On y raconte une métaphore, à prendre au sens littéral : les enfants sont des monstres. Nous sommes en 71, Tomi Ungerer a quarante ans, est au sommet de la gloire, il a déjà bousculé beaucoup de conventions en vigueur dans la littérature enfantine. Pourtant, il prépare un nouveau livre destiné à faire grand bruit. Ce sera Pas de baiser pour maman. Un livre aux parfums auto-biographiques que Ungerer présente en ces termes : 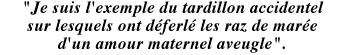 C'est l'histoire de Jo, le chaton, qui refuse obstinément les baisers de sa mère. Des adultes ont alors traité Ungerer de contestataire et d'anarchiste, de dynamiteur de la cellule familiale. Avec raison peut-être, dans la mesure ou Ungerer n'hésite pas à déclarer qu'il a toujours voulu faire des livres d'enfants qui ne plaisent pas aux parents. Tandis qu'une fois encore les enfants font au livre un accueil triomphal. Le scandale n'y vient plus d'animaux réputés répugnants (auxquels le public s'est habitué), mais de cette image scatologique, jusque là interdite dans le monde stérilisé du livre d'enfants. "Je ne suis plus un bébé" répète Jo, qui étouffe sous l'amour de sa mère, qui refuse de se brosser les dents, qui lit des bandes dessinées a lieu de prendre son bain, qui chaque matin défait avec hargne la pile de vêtements bien lavés et repassés qu'elle lui a préparé la veille. Les enfants adorent le "parler vrai" de Ungerer, fut-il grinçant aux yeux des parents, parce qu'il refuse l'angélisme. Ungerer sait que les enfants sont cruels, méchants, agressifs, rebelles, et que c'est à cela que sert l'éducation. Assurément il y a de la provocation dans ce récit : "Si j'ai conçu des livres d'enfants c'était d'une part pour amuser l'enfant que je suis, et d'autre part choquer, pour faire sauter à la dynamite les tabous, mettre les normes à l'envers... ce sont des livres subversifs, néanmoins positifs" (1). Jo a tout pour devenir délinquant. Il est le meneur de la classe, fournisseur entre autres de boules puantes, de frondes et de pétards. L'école, lieu d'apprentissage du social. Apprendre, c'est-à-dire prendre des risques, faire des gaffes. Éprouver les limites, le cadre. Si l'image du père se fait discrète dans Pas de baiser pour maman, elle joue néanmoins un rôle capital. Au moment des conflits, c'est le père qui intervient pour indiquer les bornes à ne pas dépasser. C'est le père encore qui fait comprendre au gamin la relativité du problème, lui expliquant que lui aussi, à son âge, il connaissait les mêmes tensions, utilisait les mêmes trucs, tombait dans les mêmes pièges. Tomi Ungerer propose donc l'image d'un père quasi absent, mais sage, et complice. Il s'agit d'une histoire dessinée aux crayons. Mais proposant la palette quasi complète des possibilités du médium, en un florilège d'effets qu'on ne peut apprécier pleinement que sur les originaux, l'impression dans les livres atténuant les audaces et une part du savoir-faire du dessinateur. |
|
Un bien étrange graphiste Un tel succès dans la littérature pour enfants, culturel et commercial, ne peut qu'éveiller certains intérêts. Aussi, dès le début des années soixante, des publicitaires sonnent à la porte de Tomi Ungerer, par exemple Swissair qui commande une série de posters. Aucun parmi la vingtaine de projets soumis ne peut être retenu, pour la raison évidente que Ungerer s'y amuse sans penser une seconde à la valorisation du produit, dessinant par exemple un Suisse lâchant sa meute de loups sur les touristes, des touristes vus comme des moutons qui font du ski, ou encore cette image de couple s'envoyant en l'air grâce à Swissair. Il faut regarder de près le visage de l'homme, ses dents de vampire, son regard noir et concupiscent, pour comprendre que cette confusion ne colle pas à l'image de confort, de clarté, de bienséance et d'efficacité que revendique la compagnie aérienne. Ce projet, et les autres, étant la meilleure manière de faire fuir les clients, est refusé. Ungerer s'est bien amusé. Que peut donc bien désirer ce vieil homme tout nu ? De quel fruit s'agit-il ? Où est la promesse du produit, pour parler le jargon des publicitaires ? L'image est pourtant interpellante, pas du tout banale, lisible, et facilement mémorisable. Je laisse à votre imagination le soin de chercher... Jamais Ungerer ne met de l'eau dans son schnaps, comme le constatent en 1967 les dirigeants canadiens de Calvert Gin. Il s'agissait en effet de promouvoir un gin fabriqué au Canada.  Projet refusé 1966 Ungerer propose des images fortes, que l'on prend ou que l'on laisse. Mais jamais il ne transige, jamais il n'entre dans la logique de prudence, de consensus absolu, de communication idéale que réclament la plupart des annonceurs publicitaires. Et tant pis pour les Parcs nationaux américains qui se passent d'une telle affiche parce qu'elle risquerait de mécontenter un fragment de l'opinion. Il n'est pas étonnant dès lors que les cartons de Tomi Ungerer soient remplis de projets avortés, disant bien la priorité du graphisme d'auteur que revendique Ungerer. Sa position est celle de l'artiste, qui ne peut fonctionner dans un cadre redevable au grand public, à court terme, même s'il se sent concerné par les enjeux sociaux. En effet, les objectifs et la logique du créateur sont différents de ceux du publicitaire. Sa manière de travailler est simple, il dessine et trouve des idées, qu'il adapte s'il échet à l'un ou l'autre produit, qu'il s'agisse d'une commande ou d'un jeu auquel il se livre gratuitement. Il faut donc se rappeler à tout moment, que n'importe quelle idée de Ungerer a suffisamment de potentiel pour devenir utile à l'un ou l'autre produit commercial. Tous les dessinateurs ne peuvent en dire autant ! |
|
Le cirque et la révolution L'impact de "Kiss for Peace", en 1967, est immense, quoique controversé. Le poster est vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires partout dans le monde. Il cristallise l'antithèse du discours officiel par lequel l'Amérique se bat pour une cause juste et noble. D'autre part on imagine bien les inimitiés que provoque la diffusion de cette image. Ce dont Ungerer n'a cure, car il pratique une des plus anciennes recettes de la publicité, disant qu'en bien ou en mal, peu importe, l'important est qu'on en parle. Comment expliquer que, parmi des centaines d'autres, cette affiche ait tellement frappé les imaginations ? Le décalage entre les mots et l'image joue ici à plein. "Kiss", embrasser, pour une image abjecte. Le mot "paix" jouxtant une image de violence, aveugle comme le militaire bien campé sur ses jambes, et dont l'uniforme, notamment le casque, rappelle celui des nazis, et la bouche sans lèvres celle des reptiles. On devine le Vietnamien à genoux, les mains liées derrière le dos. Il est nu. On lui tire les cheveux, lui pressant la gorge. Il lui faut, sous la contrainte et en public, embrasser le derrière de la Liberté que l'on reconnaît à sa coiffe. Elle retrousse son vêtement, le drapeau américain, sous lequel elle apparaît nue, vulgaire comme la pire des chiennes. Même pas, sa morphologie générale, l'épaisseur de ses jambons la rend grasse comme une truie. La statue originale guide le monde de sa torche, "debout, droite, digne, tournée vers les sommets" pour reprendre les mots de De Gaulle lorsqu'il parlait de la France. Ce modèle de Liberté devient un animal lubrique, pas un symbole. La tonalité générale de cette affiche passe du noir au vert, avec des rehauts de rouge. Elle joue la froideur alors que le coloris original du drapeau américain arbore le rouge, le blanc, le bleu en un ensemble davantage solaire. Noir, vert, comme le négatif d'une photographie couleur, impression renforcée par la dureté des contrastes en noirs et blancs. Noir, vert, gris, cette image s'inscrit dans la tradition du Guernica de Picasso, tant par le thème que par la façon de présenter les éléments de face ou de profil, côte à côte sur une surface sans profondeur. Il faut encore remarquer le rappel de la structure globale du drapeau américain : le texte à l'endroit et dans le rectangle dévolu aux étoiles, en haut à gauche, les rayures et les bras des personnages à la place des bandes, etc. Une des explications du succès de cette affiche pourrait donc résider dans le fait que Ungerer y superpose deux régimes, l'image (de la Liberté) et la structure spatiale (du drapeau américain). Deux négatifs superposés, celui de l'image, et celui de la couleur. La guerre, Ungerer connaît : "Vint la guerre et en une nuit nous devînmes Allemands. Une nouvelle école, de nouveaux enseignants. Cela me laissa une grande impression et me donna ma première leçon de relativité et de cynisme - les camps de prisonniers, la propagande, les bombardements, le front russe, le manque de tout. Tout ceci culmina en apothéose lorsque nous fûmes pris dans la poche de Colmar durant trois mois en hiver 44-45. Avec une ligne de front quasi sur le pas de notre porte, les bombardements et la vie dans la cave était notre lot quotidien. Je dois admettre que ma vision d'enfant n'en faisait qu'un gigantesque cirque" (2). |
||
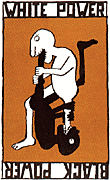 |
Un cirque avec ses représentations dans lequel rien ne manque, même pas les acrobates. "Les soldats français qui habitaient chez nous m'ont enseigné mes premières cuites. Les Allemands, eux, voulaient pendre en grappes des Juifs aux marronniers du jardin. Quant aux libérateurs américains, ils nous ont volé notre dernier pot de confiture. Tout ça permet de relativiser" (3).
L'un vaut l'autre et tous se bouffent. Ungerer les renvoie dos à dos, en une image qui tourne en rond et revient toujours à son point de départ. Elle est d'ailleurs structurée comme une croix
gammée.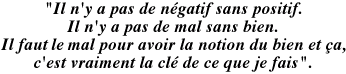 |
|
| (4) |
||
| "Le retour des Français reste encore pour moi la plus grande désillusion de ma vie... Libération allemande ou française, elles avaient en commun les brasiers dévorant les livres". Un grand cirque avec ses illusionnistes qui annoncent un autre prodige, dans le chef de la Révolution française et de ses têtes volantes. Révolution, que d'espoir n'avons-nous pas portés sur ton nom ! Pourquoi nous avoir ainsi déçus, apportant la haine et la terreur, le sang, alors que tu ne parlais que de fraternité, d'égalité, de liberté. Les actes des hommes ne seront-ils jamais à la hauteur de leurs idées ? "Il n'y a pas de gloire sans charnier ! Le charnier avec son harem de charnières vissées sur les trappes des victimes englouties par les bouleversements physiques de l'immédiat. Il n'y a pas de gloire sans violence cocardée, drapée d'un beau drapeau qui flirte avec les arcs en ciel et les arcs de triomphe"... "La célébration du bicentenaire de la Révolution Française est ambiguë. Au nom de notre prestige nous faisons de la prestidigitation". "La Déclaration des Droits de l'Homme - cet incomparable document, aussi humaniste qu'humanitaire ! - n'a-t-elle pas été bafouée, piétinée, ensevelie par les égarements d'une populace déchaînée par le fanatisme. Et pourtant, comment exprimer assez mon respect pour ce peuple qui nous a donné l'Armée du Rhin, Valmy, l'abolition des privilèges et de l'esclavage" (5). "Mais pourquoi tout cela ? Pour que la République, Marianne à genoux, s'offre à Bonaparte qui engendre par elle son empire. La virginité d'une révolution finit toujours dans le proxénétisme... Les arènes sanglantes de nos ancêtres les Romains sont remplacées par la téléfiction. Mes enfants préfèrent la violence d'une chasse à l'homme à l'aventure paisible d'une amitié. C'est dans la nature des choses" (6). On sent Ungerer sur son terrain lorsqu'il parle de révolution, lorsqu'il dessine des images cul par dessus-tête, littéralement. La révolution serait d'ailleurs une des images clés de son dispositif graphique, à condition d'en retrouver l'étymologie, le sens que lui donnent les spationautes, le retour au point de départ. |
| 1. 33 Spective, Anstett, Strasbourg, 1990 |
| 2. 4. Testament, Diogenes Verlag AG, Zürich, 1985 |
| 3. Lectis numéro 6, Strasbourg, 1992 |
| 5. 6. Perspectives 89, 12e Festival du Théâtre français, Saarbrücken, 1989 |