|
|
| Quelques "échos graphiques"... L'oeuvre graphique de Tomi Ungerer vient d'être esquissée dans les grandes lignes de ses genres et de ses thèmes ; elle se situe également dans une continuité artistique, dont témoignent ces quelques "échos graphiques" que nous allons évoquer. Que l'oeuvre de Tomi Ungerer ait des correspondances avec des dessinateurs satiriques comme Hogarth, Daumier et Grosz, est un fait reconnu et incontestable. Il en existe cependant bien d'autres, car Tomi Ungerer l'autodidacte a puisé largement à des sources iconographiques et littéraires très diverses... Dans la préface de Babylon, Friedrich Dürrenmatt a d'ailleurs souligné qu'"il n'imitait personne, mais utilisait beaucoup". L'artiste esquisse lui-même son propre itinéraire, en citant pêle-mêle ses modèles : "Enfant, j'ai été essentiellement impressionné par Mathias Grünewald, Dürer, Schongauer ainsi que par Hansi et Schnug, tous les deux des artistes alsaciens, plus tard par Goya, Bosch, les dessinateurs japonais (Hokusaï, etc.), les vieux numéros du Simplicissimus et Wilhelm Busch (3)". C'est dans les livres que son père, bibliophile émérite, avait réunis avec passion, qu'il fit dans sa jeunesse, ses premières rencontres avec l'art : Les Contes drôlatiques de Balzac illustrés par Gustave Doré, L'Alsace racontée aux petits enfants de Hansi voisinaient avec les premières éditions du Simplicissimus, Max und Moritz de Wilhelm Busch et Les Nouvelles genevoises de Rodolphe Töpffer. Cette double culture, française et allemande, imprégnera l'oeuvre de Tomi Ungerer. Puis ce fut à l'âge de dix ans qu'il vécut le grand choc artistique de sa vie en découvrant aux Unterlinden de Colmar le chef-d'oeuvre de l'expressionnisme rhénan, le Retable d'Issenheim de Mathias Grünewald... S'il occupe une grande place dans ses souvenirs, paradoxalement, il ne resurgit que sous une forme anecdotique dans son oeuvre... En effet, des détails de "la Visite de Saint Antoine à l'ermite Saint Paul" du retable, le corbeau qui apporte son pain quotidien à l'ermite et l'arbre moussu aux formes inquiétantes, ont été malicieusement transposés dans un coin du décor rhénan de L'Apprenti Sorcier... Comme si Tomi Ungerer, de cette manière, voulait nous montrer son détachement par rapport à ses modèles... En revanche, des Maîtres de la Renaissance allemande, dont il admirait déjà les tableaux lors de sa jeunesse dans les musées bâlois, Tomi Ungerer a retenu non seulement les thèmes, comme par exemple celui de "la Jeune Fille et de la Mort", mais aussi une leçon graphique... Ainsi une comparaison s'impose entre un dessin inédit que Tomi Ungerer a réalisé dans les années 80 sur le thème des sorcières, et une gravure de Baldung éditée à Strasbourg en 1510, du même thème. Dans une vision qui mêle l'érotisme aux forces diaboliques, Baldung représente des sorcières en train de vaquer aux occupations d'un sabbat. A la sorcière qui s'envole sur le dos d'un bouc chez Baldung, succède celle qui s'est étendue sur le dos d'un animal cornu et griffu venant des Enfers, chez Tomi Ungerer. Elles ont en commun un trait plein de vigueur et de réalisme... De Dürer, cet autre maître de la Renaissance, dont les aquarelles d'animaux et de plantes lui servent de référence quand il réalise ses dessins d'observation, il aime la pureté de la ligne. Les "Chipmunks", ou tamias du Canada que Tomi Ungerer a dessinés dans Nos années de boucherie présentent des similitudes dans leurs attitudes avec les "Ecureuils" peints par Dürer en 1512 et ont été réalisés avec une spontanéité du trait et un souci de précision identiques accrus par l'utilisation de la plume et du lavis d'encres. À cet axe culturel alémamique esquissé par Grünewald, Baldung et Dürer, se sont ajoutées d'autres sources picturales et graphiques dont l'éclectisme correspond à la diversité des styles de Tomi Ungerer : le romantisme, le dadaïsme, les dessinateurs satiriques du XIXè siècle, les "cartoomists" anglo-saxons et Georg Grosz, par exemple, l'ont tour à tour inspiré. |
|
Le romantisme C'est particulièrement dans l'illustration des chansons populaires allemandes du Grosse Liederbuch que Tomi Ungerer s'est souvenu du courant romantique. Parmi les peintres romantiques allemands, ce sont Caspar David Friedrich, Carl Spitzweg, Ludwig Richter et Moritz von Schwind, qui ont été ses modèles préférés. Certains de leurs thèmes, comme les scènes de la vie bourgeoise et paysanne, la nostalgie du passé et le goût des ruines, l'amour de la nature, l'ont inspiré. La structure même du Grosse Liederbuch a été conçue d'après les cycles de bois gravés de Ludwig Richter (1803-1884) qui étaient destinés à redécouvrir et idéaliser l'âme allemande à l'époque Biedermeier. Le livre s'ordonne en effet comme les Volkslieder, ou recueils de chansons populaires, en chapitres de saisons, de moments de la journée, de métiers artisanaux, de fêtes, de coutumes populaires et de légendes. Tomi Ungerer, pour les illustrer, a réalisé de véritables petites scènes de genre, qui cependant se détachent de leur modèle romantique par l'ironie qu'elles dégagent. 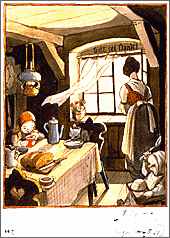 1985 Prenons pour exemple le dessin qui accompagne une chanson du matin, "So fröhlich wie der Morgenwind" (Aussi joyeux que le vent du matin) : une jeune mère de famille regarde par la fenêtre, dans la lumière du soleil matinal. Ce thème, très romantique, a été traité par exemple par Moritz von Schwid, dans "Die Morgenstunde" (Huile sur toile, 1858). Les deux femmes sont plongées dans la même rêverie romantique que leur procure le monde extérieur, mais chez Tomi Ungerer, la quiétude de cet intérieur bourgeois, dont on aperçoit l'horloge à balancier et la lampe à pétrole, va être troublée par des enfants et un chat turbulents. La dimension satirique que prend la scène est d'ailleurs relevée par la présence ironique d'une sentence sur le linteau de la fenêtre : "Gott sei Dank" (Dieu soit loué !) Un autre thème romantique par excellence est la nature, omniprésente dans Das Grosse Liederbuch. Le dessin qui accompagne une chanson sur le thème de la nuit, "Der Mond ist aufgegangen" (La lune s'est levée), illustre le rapport entre l'homme et la nature qui est au centre de la problématique romantique. Un couple vu de dos contemple la clarté laiteuse de la lune, et semble se fondre dans l'immensité de la nature. Comme dans le tableau de Caspar David Friedrich "Un homme et une femme contemplant la lune", les personnages sont entrés en communion avec le paysage. Comme chez Friedrich également, la nature, et particulièrement l'arbre, est parfois l'unique sujet de l'image. Dans "Alleluja", un arbre enneigé aux branches noueuses, fier malgré sa nudité, semble soutenir le ciel ; le graphisme de l'arbre, le contraste entre la puissance du tronc et le ciel brumeux rappellent le tableau de Friedrich intitulé "Chêne dans un champ de neige". Dans les deux cas, les arbres sont personnalisés, presque anthropomorphes. Tomi Ungerer a rendu ici hommage à son modèle romantique dont il admire particulièrement la maîtrise avec laquelle il représente les arbres. Mais ce qui fait l'originalité du Grosse Liederbuch par rapport à ces thèmes romantiques, ce sont les images d'une Alsace mythique et idéale dont Tomi Ungerer accompagne les chansons allemandes... Il faut évoquer à ce propos la figure de cet artiste romantique que fut l'Alsacien Gustave Doré. On peut en effet dresser un parallèle entre les deux artistes dont l'inspiration est parfois identique d'un siècle à l'autre. Loin de leur région natale, ils ont gardé en mémoire paysages alsaciens et forêts vosgiennes qu'ils ont parcourus dans leur jeunesse lors de promenades familiales, et qui resurgissent, comme des leitmotivs, dans leur oeuvre. Dans "Bunt sind schon die Wälder" (Déjà l'automne colore les forêts), par exemple, une chanson de l'automne, Tomi Ungerer représente une scène typiquement vosgienne du siècle dernier : des bûcherons s'activent, au premier plan un schlitteur s'arc-boute à son traîneau chargé de bois pour en contrôler la vitesse. Il donne une vision romantique, presque folklorique, de ce métier aujourd'hui disparu en habillant ses personnages de gilets rouges alsaciens. La composition d'ensemble rappelle une lithographie de Doré, "Schlitteurs aux environs de Barr", qui date de 1857, et dont Tomi Ungerer s'est certainement souvenu. Les images de la forêt vosgienne sont très présentes dans Das Grosse Liederbuch. Dans un dessin qui illustre le poème de Goethe, "Ich ging im Walde so fùr mich hin" (En allant me promener dans la forêt), un promeneur solitaire, plongé dans sa lecture, marche à travers les hautes futaies d'une forêt vosgienne : l'éclairage par des faisceaux de lumière qui traversent en diagonale la verticalité des troncs, donne à la scène une intensité dramatique, et évoquent la propre expression de Tomi Ungerer de "Forêt cathédrale". Images d'une forêt mythique, les fûts d'arbres gigantesques aux racines sinueuses évoquent ceux que Gustave Doré a représentés dans l'une de ses illustrations du "Petit Poucet" Autre élément d'une Alsace rêvée, les ruines de châteaux forts qui servent de décors aux dessins du Grosse Liederbuch : pour illustrer la chanson "Als ich bei meinen Schafen wacht" (Quand je gardais mes moutons), Tomi Ungerer prend comme modèle les trois châteaux d"Eguisheim en Alsace. Leur masse inquiétante, juchée sur un haut promontoire, est éclairée d'une lumière mystérieuse, et évoque la burg en ruines d'un dessin de Doré, "Le château de Haut-Andlau". Ces quelques exemples montrent que les dessins du Grosse Liederbuch ont donc fourni à Tomi Ungerer l'occasion d'exprimer sa double culture, d'une part en reprenant les thèmes romantiques allemands et d'autre part en retrouvant comme Gustave Doré les images d'une Alsace mythique ... |
|
Le dadaïsme et le surréalisme Si le romantisme a trouvé des résonances profondes chez Tomi Ungerer, le dadaïsme et le surréalisme sont des mouvements qui correspondent à son goût de la fantaisie et de la dérision. C'est en effet dans une véritable démarche dadaïste que s'inscrit Tomi Ungerer quand il se met en quête de l'absurde : dans la lignée de son prédécesseur alsacien Jean Arp, co-fondateur du mouvement Dada, il joue avec les mots et les associations d'idées, générateurs d'images. Comme les dadaïstes, Tomi Ungerer détourne les objets fabriqués en série de leur fonction première et les assemble de façon hétéroclite pour se moquer de l'art. Il réalise, dans l'esprit des ready-made de Marcel Duchamp, des objets-assemblages, composés d'objets du commerce fabriqués en série, quotidiens, insignifiants ou hors d'usage comme la ludique famille d'animaux qu'il a baptisée Félix, César, Castor et Pollux et qu'il a fabriquée avec des pelles, râteaux, tuyaux, ressorts, et outils divers... Dans ce même esprit, il a consacré en 1987 un livre, Fundsachen, à des objets trouvés dans des dépotoirs, et qu'il considère être les témoins de ce qu'il nomme un "art sans artiste". Des surréalistes il a repris le procédé du collage, dont il tire des effets poétiques et absurdes. Dans son livre Horrible, il associe aux dessins à l'encre de Chine des reproductions photographiques de catalogues illustrés, imaginant par exemple un chien affublé d'un objectif d'appareil photographique en guise de muselière, dans la continuité de Max Ernst qui donnait naissance avec ses collages à des êtres fantasmagoriques... |
|
Les dessinateurs satiriques Si ces différents mouvements artistiques, le romantisme, le dadaïsme et le surréalisme, ont joué un rôle pour Tomi Ungerer, c'est cependant dans la continuité graphique de ses prédécesseurs du dessin satirique qu'il, se situe véritablement : Hansi, Wilhelm Busch, Rodolphe Töpffer, dont il découvrit les livres dans la bibliothèque paternelle, les "cartoonists" new-yorkais et Georg Grosz dont il connut les oeuvres plus tard. Il a réalisé ses premiers dessins satiriques dans sa jeunesse, pendant la guerre. Ce sont les caricatures de Jean-Jacques Waltz, dit Hansi, qui fit une satire féroce de l'occupant allemand en Alsace entre 1870 et 1918, qui l'inspirèrent à cette époque : "Mes dessins d'enfant reflètent un condisciplinage absolu avec Hansi." se souvient Tomi Ungerer (4). Ainsi, à l'exemple des caricatures de l'armée de Guillaume II, Tomi Ungerer dessina des portraits charge d'officiers allemands. De la même manière que Hansi, il a exagéré et déformé les traits physiques de ses personnages, témoignant déjà d'un grand esprit d'observation, qualité essentielle à tout dessinateur satirique. Deux auteurs du XIXè siècle et d'origine allemande, Rodolphe Töpffer et Wilhelm Busch, ont également impressionné Tomi Ungerer dans sa jeunesse... Entre Rodolphe Töpffer, à qui revient la paternité de la bande dessinée, et Wilhelm Busch, dont l'histoire de Max und Moritz est devenu un classique de la littérature enfantine en Allemagne, il existe une parenté évidente. Tous deux ont été des observateurs critiques des travers de la bourgeoisie de l'époque et des faiblesses humaines en général. De ces deux auteurs, Tomi Ungerer a essentiellement hérité du dynamisme graphique qui les caractérise. Dans une nouvelle intitulée "Le concert du Nouvel An", Wilhelm Busch représente un pianiste qui attaque un "finale furioso" avec tant d'impétuosité que les notes de musique s'échappent de sa partition et s'envolent. Le même sens du mouvement habite l'affiche que Tomi Ungerer a réalisée pour le festival de jazz de Zürich en 1980 : un musicien découpe avec férocité sa partition dont les notes de musique semblent être douées de vie. 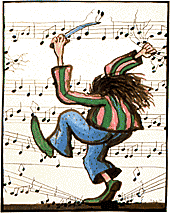 1980 C'est dans le creuset de la ville de New York et dans les années 60, que Tomi Ungerer, suivant l'exemple d'autres dessinateurs de sa génération comme R. O. Blechman, Shel Silverstein, André François, Paul Flora, Ronald Searle, ou Hans Georg Rauch, adopta le genre du "cartoon", très en vogue à cette époque. En fréquentant à Strasbourg au début des année 50 le centre culturel américain, il avait découvert des magazines comme Life, Holiday, et surtout le New Yorker qui exerça sur la génération des dessinateurs européens d'après-guerre une grande influence. Grâce à Saül Steinberg et à James Thurber en particulier, se développa dans ce magazine dès les années 40, le genre du "cartoon", dessin humoristique et satirique accompagné d'une légende très courte ou sans légende, et caractérisé par un trait simplifié et stylisé, et qui est devenu depuis indissociable du dessin de presse. Saül Steinberg, tout d'abord, a particulièrement fasciné Tomi Ungerer, qui avait même souhaité le rencontrer à New York : cet artiste d'origine roumaine réfugié aux Etats-Unis, collaborateur du New Yorker en 1942, était devenu un maître incontesté du dessin satirique. Dans un dessin de 1959, Steinberg tourne en dérision les différents symboles de l'Amérique, en juxtaposant l'oncle Tom, Santa Claus, l'oncle Sam, les allégories du bonheur et de la prospérité, etc ... Ce qui caractérise son style est l'introduction dans son graphisme de caractères typographiques, de chiffres, de mots, de formes géométriques, ainsi que son trait acéré et synthétique. Comme Saül Steinberg, Tomi Ungerer a pris comme cible de sa critique la société et la démocratie américaines en utilisant les figures emblématiques de l'Amérique, la Statue de la Liberté, l'oncle Sam, ou le drapeau américain... On ressent également l'influence sur Tomi Ungerer à cette époque d'un autre "cartoonist" américain, James Thurber. Collaborateur comme Steinberg du New Yorker dans les années 30-40, il est le premier à y faire paraître des fables, histoires courtes à but moralisateur, au dessin très stylisé, où il critique la société avec un sens de l'humour très particulier. Tomi Ungerer raconte qu'une fable de Thurber intitulée "The last flower", partie en 1939, et dont le sujet est la fin du monde provoquée par une explosion atomique, l'a fortement impressionné. En effet, il reprend cette formule, héritée également des histoires en images de Töpffer, dans deux livres de satire sociale qui dénoncent les faiblesses humaines, Spiegelmensch, dont le héros est un homme qui explore l'autre côté du miroir et Basil Ratzki, l'histoire d'un rat qui veut réformer la société. De Hansi, Wilhelm Busch, Saül Steinberg et James Thurber, Tomi Ungerer a donc essentiellement retenu les thèmes et les procédés satiriques qui conviennent à son esprit caustique et la rapidité de son trait. Avec Georg Grosz, peintre expressionniste et dadaïste, et dessinateur satirique, il a en commun une sensibilité qui s'exprime dans leur critique de la société bourgeoise et de la guerre, traitée avec un même trait aigu et agressif. La satire violente de la société new-yorkaise et américaine par Tomi Ungerer ressemble par exemple étrangement aux scènes de la vie berlinoise des années 20 de Georg Grosz. Dans un dessin de Rigor Mortis intitulé "Une morte parmi les vivants", le dessin incisif de Tomi Ungerer met en valeur le sentiment de la pourriture d'une société qui se défait et d'une décadence à laquelle est liée l'idée de la mort. La parenté est évidente avec une oeuvre de Georg Grosz, intitulée "Früh um 5 Uhr !" et faisant partie de la série Im Schatten : il exprime par la représentation caricaturale de ces femmes et de ces hommes, l'hypocrisie d'une classe sociale. Tomi Ungerer, comme Georg Grosz illustrent ainsi les propos de Michel Vovelle : "L'apparente quiétude bourgeoise appelle elle-même la présence de la mort". L'iconographie de la guerre présente également des similitudes chez les deux artistes. Dans un dessin de Rigor Mortis, le squelette d'un général habillé d'un uniforme couvert de médailles est assis dans une chaise roulante. La cruauté de cette image rappelle celle d'un dessin de Georg Grosz qui en 1916 avait utilisé le même sujet : un général à tête de mort portant la croix de guerre et l'uniforme, se tient debout dans un décor de ruines encore fumantes. Ces images expriment à la fois la rencontre de l'angoisse de la mort personnelle et de la conscience d'une mort collective. A la lumière de ces quelques exemples, il paraît évident que les axes essentiels sur lesquels se situe l'art de Tomi Ungerer sont les contextes germanique et anglo-saxon, qui, par leur tradition graphique, ont permis son épanouissement. Cependant, dans cette tentative de retrouver les résonances artistiques de son oeuvre, d'autres pistes demandent à être approfondies comme le japonisme, les Nabis, Goya, ou Daumier, sans oublier le domaine littéraire avec les existentialistes et les écrivains américains comme Faulkner et Steinbeck... Tomi Ungerer, dans son oeuvre graphique, ne cesse de surprendre par la diversité de ses moyens d'expressions, la richesse de sa thématique et de ses sources. Cet aspect essentiel de sa personnalité si complexe reflète, comme chez un humaniste de la Renaissance, un esprit curieux et attiré par la connaissance. L'écriture, par exemple, ce dont témoignent par exemple cinquante volumes de ses écrits, aphorismes et notes, demeurés inédits, est un côté méconnu de l'artiste. Le dessinateur satirique Tomi Ungerer appartient donc, comme ses prédécesseurs Gustave Doré et Jean-Hans Arp, à cette lignée de créateurs multiformes issue du pays rhénan et qui se caractérise par le goût du paradoxe et de l'humour, et par le sens de la dérision. Thérèse Willer |
| 3. Das Tomi Ungerer Bilder und Lesebuch, Zürich, Diogenes Verlag, 1981, p. 229 |
| 4. Pierre-Marie Tyl, Marc Ferro, Tomi Ungerer, Georges Klein, Le grand livre de l'oncle Hansi, Paris, Herscher, 1982, p. 18 |