
|
 |
La Grande Guerre
Cependant, au mois d'août 1914, la guerre éclate. Les murs se couvrent d'avis de mobilisation. Les états-majors, qui ont cru à une guerre de mouvement qui ne durait pas, n'ont rien prévu en terme de propagande, excepté la censure, qui se met rapidement en place.
En Allemagne, deux organismes de propagande ont été créés dès août 1914 mais le côté bicéphale de cette organisation a nui à son efficacité. Seule la propagande américaine, centralisée, mais privée, s'avérera vraiment efficace.
Au début du conflit, ce sont donc en majorité des affiches textes, avis divers , ou état de l'évolution du conflit.
Mais à partir de 1915, les nations en guerre commencent à réfléchir à une action par l'image.
La production d'affiches est nécessaire pour deux raisons principales : on manque d'hommes, notamment en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, et on manque d'argent pour tous les pays entrés en guerre.
Il était nécessaire dans les pays ne pratiquant pas la conscription, d'inciter les hommes à s'engager dans l'armée. En Angleterre, les affiches de recrutement ont été nombreuses et de qualité inégale, en voici quelques exemples.

"Britons", affiche d'Alfred Leete
représentant Lord Kitchener,
1914
L'affiche d'Alfred Leete, "Your country needs you", montrant le visage de Lord Kitchener, le doigt pointé et le regard accusateur, est très célèbre. Elle va être reprise un peu partout, aux Etats-Unis notamment avec James Montgomery Flag et l'Oncle Sam.
Les Etats-Unis, entrés en guerre tardivement, ont eux-aussi eu recours à l'affiche de recrutement pour inciter les hommes à s'engager. Ils ont utilisées des images plus fortes, tournées vers la gaieté, la camaraderie, ou la violence, on le verra par la suite.
La guerre est un véritable gouffre financier, les besoins en armes et munitions sont énormes, tous les états doivent emprunter, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donner son argent devient donc un devoir. Toutes les nations en conflit ont eu recours aux affiches incitant les populations civiles à souscrire aux emprunts. Le mot d'ordre devient : "Le soldat donne son sang, donnez votre or" comme nous le démontre ces affiches. Les billets remplacent les munitions. Cette idée que c'est l'or qui apportera la victoire est présente à tel point qu'un grand nombre d'artistes vont la représenter à l'aide d'une immense pièce d'or qui écrase l'ennemi. Nous en avons de nombreux exemples en France avec Abel Faivre, en Hongrie, en Grande-Bretagne et en Allemagne.
Il est intéressant de noter que l'image de la guerre est quasiment absente dans la propagande des pays européens. Ainsi, la famille est très présente dans les images de propagande, nous avons constaté que le nombre d'affiches représentant la population civile était quasiment identique à celles représentant des soldats. Femmes et enfants sont l'élément de soutien des hommes mobilisés. C'est pour protéger la famille que les soldats doivent se battre. Les pères sont un exemples pour ces enfants, prêts eux-aussi à prendre le fusil.
Les efforts de propagande se portent également sur la mobilisation de l'arrière. Les femmes, en attendant le retour du soldat, mobilisent leurs forces pour les remplacer aux champs et aux usines. Elles s'engagent aussi dans des oeuvres charitables et incitent même leurs compagnons à s'engager, d'une manière tragique en Grande-Bretagne, d'un façon plus coquine aux Etats-Unis.
Les soldat est aussi très représenté, mais il est le plus souvent représenté seul, au Portugal avec cette affiche de Colomb, en France avec Abel Faivre, en Russie et en Grèce. Lorsque l'ennemi apparaît, c'est pour dénoncer ses crimes, mais lui aussi apparaît seul, jamais en situation de combat.
Lorsque la lutte est représentée, c'est en référence à un passé victorieux. Sem a choisi de nous montrer la Marseillaise de Rude, les Britanniques, l'image de Jeanne d'Arc victorieuse. Les bras armés d'épées ont des armures d'un autre temps et les combats représentés sont ceux des chevaliers luttant contre des formes animales : dragons en Grande-Bretagne et en Autriche, alligators en Allemagne.
Les armes forment aussi des représentations du passé, lorsqu' elles sont modernes, elles occupent le point central de l'affiche, donnant davantage une impression d'invincibilité qu'une vision des combats.
Cependant, à partir de 1916, avec la longueur du conflit et le retour des blessés, on ne peut plus cacher à la population civile les mutilés. Ils apparaissent donc dans les affiches, assez émouvants pour susciter d'éventuels dons, néanmoins bien vivants pour ne pas affoler ou démoraliser l'arrière.
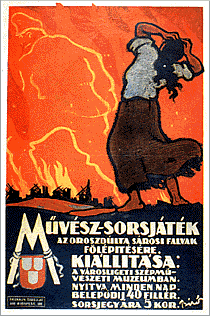
"Müvész-Sorsjàték", affiche de Biro
pour la reconstruction du village détruit de Saros,
Hongrie,1915
La réalité des combats n'apparaît dans les affiches que par la présence des orphelins, des prisonniers et l'image des ruines et églises dévastées. Mais quand la cathédrale de Reims bombardée est représentée, c'est pour dénoncer les exactions allemandes et réveiller l'ardeur patriotique.
C'est donc une guerre non représentée que nous montre la propagande des pays européens, seuls deux artistes britanniques, Spencer Bryse et Franck Brangwyn réalisent des affiches aux images de combat beaucoup plus réalistes. Leur compositions se détachent de l'ensemble de la production européenne.
Ces images restent donc exceptionnelles dans la propagande des pays où les combats se déroulent sur place. Par contre, dans les pays éloignés du conflit, Etats-Unis, Australie, la nécessité de susciter une vive émotion ont conduit les affichistes à montrer des images beaucoup plus choc. On y voit des blessés et des morts. L'ennemi y est cruel, il est sadique et barbare, il viole les femmes et assassine les enfants.
Les affiches de la Première guerre mondiale nous montrent donc une guerre en quelque sorte "édulcorée" en Europe, plus brutale dans les pays éloignés du conflit, mais jamais vraiment réaliste, la guerre ne s'affiche pas.
Il est intéressant également de remarquer la similitude des images utilisées dans tous les pays, avec la mise en place de nouveaux codes : l'utilisation du globe, de la couleur rouge, et une très importante utilisation de jeux de mains, qui se serrent, qui menacent, ou qui appellent.
Ces nouveaux codes vont être réutilisés pendant les années vingt, pour aboutir dans les années trente à la construction d'un véritable langage sur les murs.
L'entre-deux-guerres
L'entre-deux-guerres est une période bouillonnante, tant au niveau des bouleversements politiques que de la création dans le domaine de l'affiche. L'Europe, à l'image de la Russie, est secouée par des grèves et des tentatives de révolutions. En Allemagne, durant les derniers jours de la guerre, des mutineries éclatent et des soviets se forment dans quelques grandes villes. La République est proclamée le 9 novembre 1918. En janvier 1919, les chefs spartakistes, proches des bolcheviks, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht lancent une insurrection à Berlin sur le modèle de la Révolution d'Octobre. Ils sont assassinés au cours de la "semaine sanglante". Les artistes expressionnistes, Pechstein, Klein, Richter Jaeckel, Dix, Grosz... réunis dans le "groupe de Novembre" réalisent des affiches extrêmement fortes et violentes.
Des révolutions éclatent aussi en Bavière avec Kurt Eisner et en Hongrie avec Bela Kun, elles sont écrasées. Ces bouleversements ont bien sûr des répercussions dans le domaine de l'affiche.
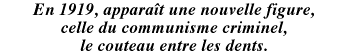
Rudi Sald l'illustre en Allemagne avec une tête de mort, en Hongrie, dans un bain de feu et de sang, il est présent en France également avec Adrien Barrère aux législatives de 1919.
En Russie, c'est la guerre civile, les bolcheviks, les rouges, s'opposent aux anti-bolcheviks, les blancs. Cette guerre durera 4 ans. Elle s'illustre par de nombreuses affiches, les bolcheviks déployant un arsenal de propagande au sein duquel ce support détient une primauté incontestable. Les affiches sont inspirées d'une double tradition, celle internationale de la caricature, et celle russe du Loubok (imagerie traditionnelle russe dont les origines remontent au XVII ème siècle). Viktor Deni symbolise le mal par un capitaliste. Pour Vladimir Fidman, l'ennemi est à l'intérieur, c'est le tsar qui s'apprête à mettre la main sur la ville de Moscou. Tandis que Dmitri Moor rejette l'intervention étrangère, comparant l'ennemi aux portes de la Russie à un squelette apportant avec lui esclavage, famine et mort.
Quant aux Blancs, ils possédaient eux-aussi un Service d'information et de porpagande (l'Oswag) dont le but éait de "détruire sans relâche les mauvaises graines semées par la propagande bolchevique dans l'esprit fruste de larges masses". Les forces blanches ne se contentaient pas de détruire la propagande bolchévique, ils ont créé également leur propre affiches. Nous ne disposons malheureusement pas d'images, mais quelques-unes exposées en 1926 par l'état-major de l'Armée Rouge montrent que ces affiches dénonçaient les atrocités bolcheviques, appelaient à défendre la liberté et la patrie et glorifiaient leurs chefs. Tandis que les artistes, du côté des blancs continuent de traiter le thème du monstre aux multiples têtes, les bolcheviks se convertissent à un style plus mordant et réaliste, plus à l'écoute des masses populaires, avec les célèbres affiches ROSTA du nom de l'agence télégraphique où elles étaient apposées. Ces affiches, facilement reconnaissables grâce à leur dessin stylisé, célèbrent le travail, ou appellent au combat. Ivan Malioutine et Vladimir Maïakovski incitent dans leurs affiches les russes à s'engager sur le front polonais.
Cette simplification est poussée à l'extrême avec les futuristes et la très célèbre affiche de El Lissitski "Le coin rouge enfonce les blancs".
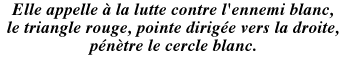
L'ensemble de l'affiche reflète un mouvement dynamique et violent que l'on peut assimiler à une métaphore sexuelle.
Bolchéviques et capitalistes représentent donc dans les années vingt les ennemis que l'on pointe du doigt selon le camp où l'on se trouve. Dans les années trente, l'apparition d'un nouveau modèle politique : le fascisme, amène de nouveaux adversaires à combattre.
Bénito Mussolini est arrivé au pouvoir légalement en 1922, mais c'est dans les années trente que, soucieux d'installer le fascisme durablement, il entreprend la révolution culturelle qui doit conduire à la réalisation intégrale de son projet totalitaire.
En 1933, Hitler, chef du parti nazi, arrive au pouvoir. Le 2 août 1934, à la mort d'Hindenburg, il se fait proclamer président du Reich et fait ratifier par un plébiscite la disparition de la république.
Contrairement à l'Italie où les futuristes ont continué de travailler. En Allemagne, l'arrivé du fascisme porte un coup fatal aux avant-gardes. Le Bauhaus ferme, les artistes sont soumis à l'avis de Goebbels, et du ministère de la propagande. Beaucoup d'entre eux préfèrent s'exiler.
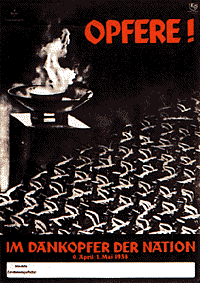
"Opfere"
"Sacrifiez-vous en offrande à la nation",
Allemagne,1938
En Italie, une propagande très efficace contrôle tous les domaines de l'information et de la vie culturelle. En 1933, un sous-secrétariat d'Etat à la presse et à la propagande est créé, qui devient en 1937 le ministère de la culture populaire.
Au petit bourgeois individualiste, s'oppose l'homme fasciste viril, guerrier et courageux. Ce sont de jeunes athlètes blonds au type aryen en Allemagne. Les affiches de sport en Italie développent elles-aussi ce culte de la beauté du corps.
Les images de l'entre-deux-guerres sont à l'image du chef, ce culte de la personnalité reproduit de nombreuses photographies d'Hitler. Dans cette affiche italienne d'exposition fasciste, Le Duce apparaît robotisé et reproduit à l'infini.
Il est intéressant de comparer ces images fascistes aux productions d'un autre état totalitaire : la Russie soviétique, où les portraits de Lénine et de Staline apparaissent également très largement sur les affiches.
Cette période de l'entre-deux-guerres voit aussi la création de nombreux emblèmes (après celles des syndicats).
L'Armée Rouge et le régime bolchevique en effet ont adopté en avril et juillet 1918 comme emblèmes l'étoile rouge ainsi que la faucille et le marteau.
Adolphe Hitler choisit, lui, en 1920 la croix gammée.
Le salut à la romaine est adopté par Mussolini et les fascistes italiens, il est repris par les nazis comme signe de révérence au chef. Ces signes sont très largement utilisés dans la propagande fasciste. Cette affiche allemande de 1938 représente ces bras levés avec une force exceptionnelle.
Leurs opposants réutilisent ces codes pour leur propre compte, Lektar en 1928 associe la croix gammée au sang et à la mort, Cabrol préfère caricaturer Hitler et reprend pour le compte des communistes l'homme au couteau entre les dents.
La réplique antifasciste ne se fait pas attendre, Serge Tchakotine invente en 1932 un nouveau symbole : les trois flèches destinées à barrer la croix gammée. Il est utilisé dans cette affiche pour le Populaire.
Ils répondent au salut romain par le poing levé, adopté en Allemagne en 1928 comme refus du nazisme. Les socialistes flamands l'utilisent en 1934.
Les images antifascistes de l'entre-deux-guerres réutilisent et inventent de nouveaux symboles : la couleur rouge est omniprésente dans les affiches, elle représente le feu et le sang pour les anticommunistes, alors qu'elle est prise dans un sens positif pour les communistes.
Les emblèmes sont aussi utilisés dans un sens comme dans un autre.
Les mains sont également toujours très utilisées, elle symbolise la menace bolchevique dans cette affiche allemande de Lucien Bernhard en 1919.
La Révolution à réaliser doit être une révolution mondiale, les images de globe indiquent bien ces nouveaux enjeux. Wilchar l'illustre pour la paix en 1936, Lénine balaie de la terre rois, popes et capitalistes en 1920 , tandis que les brigades internationales, pendant la guerre d'Espagne, plantent le drapeau sur le globe.
L'affiche politique est omniprésente pendant la guerre d'Espagne. De nombreux artistes comme Miro entreprennent spontanément de produire des affiches. Des organismes de propagande officiels sont créés : le Comisariat de Propaganda de la Generalitat en octobre 1936, le Departamento de Piensa y Propaganda en novembre et le Ministerio de Propaganda du gouvernement républicain en décembre.
Du côté républicains, les partis, syndicats et comités républicains exaltent la révolution en
marche, se moquent de l'Eglise et des capitalistes. Le soldat représente le prolétariat ou est le héros invincible à la poitrine nue.
Du côté des nationalistes, l'affiche politique détient un rôle moins important, Les affiches produites exaltent les notions de patrie et de justice, et reproduisent de nombreux portraits de Franco. Elles aspirent à une croisade chrétienne contre les communistes, les anarchistes et les francs-maçons.
Les affiches de la guerre d'Espagne s'inspirent des productions antécédentes, on retrouve les images de soldat triomphants ainsi que le doigt levé très utilisé pendant la Première Guerre mondiale.
Néanmoins, la présence des femmes et des enfants victimes des bombardements, très présente dans la propagande destinée aux pays étrangers, donne une image beaucoup plus tragique aux affiches de la guerre d'Espagne. Ce côté tragique est renforcé par l'utilisation du photomontage. Jean Carlu l'avait utilisé dès 1932 dans cette stupéfiante composition intitulée "Pour le désarmement des nations" montrant une femme hurlant avec son enfant sous les bombardements.
La destruction du village de Getafe et les photographies des enfants retrouvés morts vont être reproduites à de très nombreuses reprises et distribuées partout.
Elles apportent une réalité que les affiches de la Première guerre mondiale n'avait pas, réalité facilement détournable bien sûr.
Le point commun de l'illustration des deux camps est l'image de l'ennemi. Il est toujours identifié à un mal absolu et on souligne l'inspiration étrangère du parti adverse. Pour les républicains, les nationalistes sont les complices du fascisme international. Pour les nationalistes, les communistes et les anarchistes sont venus de Moscou pour détruire l'Espagne.
La guerre s'achève par la défaite des républicains en mars 1939.
600 000 espagnols sont morts, 500 000 partent en exil. La guerre civile espagnole n'est pas seulement un conflit interne, elle a été le théâtre d'affrontements idéologiques internationaux préfigurant la Seconde Guerre mondiale.

 |
 |
 |