
|
 |
La Deuxième guerre mondiale
Lorsque la deuxième guerre mondiale éclate, tout est mis en place en terme de propagande. Elle est l'occasion d'une intensification avec des tirages énormes dans tous les pays. Les affichistes reprennent les images qui ont remporté quelques succès durant la Première Guerre mondiale, cette affiche grecque reprend le dessin d'Abel Faivre de 1916. Les monstres hideux, les mains qui se lèvent, l'utilisation de la caricature, toutes ces images, typiques de la Première Guerre mondiale, sont reprises tout au long du conflit afin de mobiliser les forces ou solliciter des souscriptions aux bons d'armement.
La Deuxième Guerre mondiale ne génère donc pas de réelle création dans le domaine de l'affiche, excepté l'apparition des journaux muraux avec photos à l'appui. D'autre part, la nécessité de se protéger des espions a généré une production importante d'affiches, illustrant la célèbre expression "les murs ont des oreilles" dont la qualité de certaines d'entre elles est à souligner.
Malgré ce manque de créativité, cette immense production nous montre les aspects nouveaux de cette guerre :
La Seconde guerre mondiale est un conflit qui a affecté toute la planète, de la guerre éclair en Pologne et en France, à Hiroshima et Nagasaki, les campagnes de Russie, le conflit sino-japonais, la bataille de l'Atlantique et la guerre du Pacifique, la zone des combats a largement dépassé le cadre européen. La diversité de la provenance des affiches nous le prouvent bien : ici la Pologne, la Grèce, le Luxembourg, la Norvège, le Japon, la Russie, la Nouvelle Zélande et le Canada.
Les femmes sont mobilisées une fois encore dans les usines. Néanmoins, cette mobilisation économique, scientifique et technique au service de la guerre est encore plus essentielle que pendant la Première Guerre Mondiale. Le succès viendra de la capacité à fournir une supériorité technique.

"America's Answer !"
Affiche de Jean Carlu,
1941
Jean Carlu l'illustre dans cette affiche de 1942 : la réponse de l'Amérique c'est la production. Soldats et travailleurs sont unis dans le même combat.
Les images des femmes et enfants victimes des bombardements, apparues au moment de la guerre d'Espagne, réapparaissent. Le second conflit mondial a tué autant de civils que de militaires du fait des bombardement aériens sur les villes, mais également du fait de la famine, de la déportation et des massacres.
Mais la deuxième guerre mondiale fut avant tout un conflit entre des systèmes politiques, ceux qui se réclamaient d'une idéologie fasciste et ceux qui s'y opposaient. Elle ne fut pas une lutte entre nations, mais des Français, des Belges, des Hollandais, des Norvégiens, ... ont combattu aux côtés de l'armée nazie. Des affiches appelant à s'engager dans la Waffen SS ont été apposées dans de nombreux pays. Ils y ont vu un rempart contre l'avancée du communisme, c'est "l'Europe unie contre le bolchevisme".
Au combat contre le communiste, se greffe celui contre le capitaliste, l'anarchiste, le franc-maçon. Mais celui qui est derrière tout ça c'est le juif, il est à la tête du complot. En France, on l'expose, pour mieux le reconnaître et le combattre.
De la même façon, des allemands antinazis, des Italiens antifascistes et des Espagnols antifranquistes ont combattu les forces de l'Axe dans les mouvements de résistance ou dans les armées alliées. Le symbole nazi devient la force à anéantir. Le groupe des dessinateurs russes, les Koukryniksy, associent l'image de la croix gammée à celle de la mort. Tandis que les Alliés prouvent que le symbole nazi a été démantelé grâce à l'union des forces alliées.
En conclusion de cette période de conflit, la production très importante d'affiches nous montre un conflit rééllement international, où les réalités techniques sont très présentes. Ce conflit est bien un conflit idéologique. Cependant, comme pour la Première Guerre mondiale, la violence des combats n'y apparaît pas. Pas plus que la découverte des camps de la mort, en effet, les affiches vont montrer le retour des déportés, leur aspect décharné sous-entend le système tortionnaire, mais ne vont jamais jusqu'à la figuration de l'horreur.
L'après-guerre
Au lendemain de la guerre, il s'agit de reconstruire. Mais cette reconstruction s'opère dans la peur de la bombe atomique. En 1949, Louis Aragon choisit un dessin de colombe de Pablo Picasso pour la célèbre affiche du congrès mondial des artisans de la paix. Le mouvement anticommuniste Paix et Liberté répond à cette affiche avec "la colombe qui fait boum" dès 1950 et "Jo-Jo la colombe" en 1952.
Ces affiches montrent bien l'atmosphère de lutte entre communistes et anticommunistes de l'après-guerre.
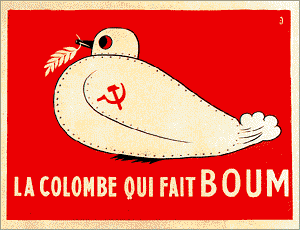
"La Colombe qui fait boum"
Affiche anticommuniste de Paix et Liberté,
1950
La guerre a laissé face à face deux grandes puissances rivales : l'URSS et les Etats-Unis.
Le prestige du communisme est immense dans toute l'Europe. Il s'explique par le rôle joué par l'Union soviétique dans la défaite de l'Allemagne nazie, par l'action décisive des communistes dans la résistance, mais aussi par l'idéologie communiste qui paraît promettre une société nouvelle où régnera la justice sociale. Ce bonheur s'illustre dans une marche joyeuse sous le regard chaleureux de Marx, Engels, Lénine et Staline, et l'image d'une famille radieuse avec l'affiche hongroise de Gebhardt Gonczi.
Les Etats-Unis, considérablement enrichis par la Seconde guerre mondiale, dominent économiquement le reste du monde, le capitalisme américain connaît son âge d'or. Il fait naître un "modèle américain" qui s'étend aux plans social et culturel, c'est l'american way of life.
En mars 1947, la doctrine Truman annonce l'entrée des Etats-Unis dans la guerre froide. (en apportant une aide financière massive aux pays menacés par la misère pour endiguer la progression du communisme. En juin 1947, le plan Marshall propose d'aider à la reconstruction des pays européens. Tandis qu'en URSS, la naissance du Kominform et la doctrine Jdanov constituent la déclaration soviétique de guerre froide en octobre 1947.
Les communistes accusent les américains de vouloir utiliser la bombe atomique. Réné Graetz l'illustre dans cette affiche Est allemande. Le symbole nazi devient le mal absolu et est utilisé dans les deux camps, Filo en Hongrie reprend le thème de la botte nazie. Le communiste représente une menace au visage et à la main couleur sang. Et c'est l'union des pays démocratiques qui stoppera l'avancée du communisme.
Cette période est donc marquée par les mêmes thèmes d'affrontement communisme - anticommunisme et antifascisme. Ce type d'images, démarré en 1919, s'interrompt avec les années soixante et la création d'un nouveau type d'images : les affiches contestataires.
Avec les années soixante : l'économie américaine perd son écrasante supériorié, la prise de conscience de la pauvreté et de la ségrégation raciale met en question l'american way of life.
Des révoltes urbaines éclatent à partir de 1964 dans les quartiers noirs et redoublent après l'assassinat de Martin Luther King. Les organisations nationalistes comme les Musulmans noirs ou les Panthères noires réclament le pouvoir au peuple. Tomi Ungerer réalise deux affiches dans ce contexte : Eat et Black Power / White Power, très forte grâce à la sobriété du texte et du dessin.
La révolte atteint aussi la défense d'autres minorités comme celle des indiens.
Enfin, la guerre du Vietnam entraîne une violente contestation contre l'impérialisme outre-atlantique. L'affiche "Why" est tirée à plusieurs milliers d'exemplaires et devient le poster accroché dans de nombreuses chambres.
Cette lutte contre l'impérialisme américain est symbolisé par l'utilisation du portrait de Che Guevara, sa mort le 8 octobre 1967 en fait un martyr, et son visage, notamment la célèbre photographie d'Alberto Corda, sera reproduit à des millions d'exemplaires.
La génération de l'après-guerre combat le colonialisme et les guerres qu'il engendre, mais aussi le capitalisme, la société de consommation et une société qui ne tolère pas la différence. Ils luttent pour l'égalité de tous, qu'ils soient hommes, femmes, blancs ou noirs, hétéro ou homo.
En Europe, dès 1965, le mouvement hollandais PROVO cristallise la contestation en réunissant ouvriers, artistes, pacifistes, étudiants, anarchistes contestataires. Les affiches de Wilhem et du groupe "le petit déjeuner au lit" ouvrent la voie de la revendication.
Une vague de contestation explose un peu partout et est caractérisée en France par mai-juin 68.
Les affiches sont des créations collectives, les plus célèbres provenant de l'atelier populaire des Beaux Arts. Tirées sur des papiers de récupération, en sérigraphie principalement. De ces contraintes techniques, naissent des images symboles très riches, au poing dressé. Elles luttent pour l'égalité de tous (nous sommes tous des juifs et des allemands, reproduisant le visage de Cohn-Bendit) contre la justice, la police, la société de consommation.
Des images du même type sont éditées à Prague lors de l'invasion des chars russes et à Mexico au moment des jeux olympiques, dénonçant la répression policière.
Alors que les ateliers populaires disparaissent peu à peu, les collectifs féministes prennent la relève dans des compositions très virulentes et colorées pour défendre les droits de la femme.
Le Women's graphic Collective crie sa frustration dans cette affiche datant de 1975. Les affiches donnent aussi la parole aux homosexuels qui détournent le che en un "che gay" en 1974.

Affiche de la Perestroïka,
Années 80
Dans les années 80, d'autres affiches contestataires naissent en Russie avec la Perestroïka. Ce sont des créations d'organismes indépendants : l'Union des artistes de Leningrad et l'Agitplakat de Moscou. Leur but est de créer des affiches qui dérangent, dont le message est de plus en virulent au fur et à mesure que s'approfondit le discrédit de la politique de Gorbatchev. Ces affiches tournent en dérision les anciennes valeurs pour un nouvel idéal : l'Amérique (on veut du Coca) et tournent en dérision les maîtres à penser d'hier.
Néanmoins, l'utilisation de plus en plus massive de photographies en couleur, l'usage de la communication politique dans les affiches électorales et la baisse du militantisme provoquent une raréfaction des images politiques. Notre espace se couvre d'affiches au portrait souriant d'hommes politiques. L'ennemi a disparu des représentations murales.
Si la crise Afghane, la crise Palestinienne, la guerre du Golfe ou la guerre en ex-Yougoslavie provoquent encore des images tragiques, elles sont le reflet des images télévisuelles. La télévision qui, en terme de propagande, prend de plus en plus le relai des affiches.
En conclusion, c'est une histoire déformée que nous livre les affiches. Déformées du fait de son rôle publicitaire, elle doit plaire. Déformées aussi du fait de son rôle propagandiste, elle diffuse un message, elle doit convaincre, même si cela passe par l'exagération ou le mensonge.
On a pu voir aussi que les images de guerre ne s'illustrent pas. Les affiches en dehors des périodes de guerre sont beaucoup plus violentes que celles réalisées pendant les conflits.
Néanmoins, l'affiche reste un atout primordial pour comprendre notre histoire, grâce à son message clair et simple. N'est-elle pas utilisée dans de nombreux manuels scolaires ? Si l'affiche ne représente pas l'histoire, elle est néanmoins riche de renseignements sur la volonté de ceux qui l'ont faite.
Fabienne Dumont
|
 |
 |