|
|
| Intervention de Mme Anne Meyer |
||
Notre conviction je parle au "nous", parce que mes partenaires qui construisent ces formations d'arts appliqués sont bien d'accord sur ce point, et je crois que c'est une pensée commune qui nous habite 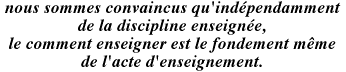 Indépendamment de ce qui s'enseigne, parce qu'il s'agit de construire des personnes et qu'au fond, qu'est-ce que c'est que la culture ? La culture ou l'intelligence, c'est cette capacité particulière à interactiver tout un champ d'expériences diversifiées les notions, le savoir, l'observation du monde, sa dimension individuelle et dans des domaines les plus ouverts et les plus divers qui soient. Et indépendamment du fait qu'institutionnellement pour entrer en arts appliqués, il faut un très très bon dossier scolaire, il est bien évident qu'il y a une synergie. Mais on va aller peut-être un petit peu plus loin que simplement le fait du langage ou de la préoccupation intellectuelle : je parlerais des méthodologies. Je parlais tout à l'heure de discipline instrumentale, au sens où vraiment ce sont des instruments dont il faut pouvoir se servir. Lorsque nous réfléchissons sur un projet de conception et de création industrielle, nous ne faisons rien d'autre, en quelque sorte, que de mettre en pièces l'état des lieux qui nous est proposé par un texte qu'il faut comprendre, avec des logiques qui sont très proches de l'arborescence que met en oeuvre la logique philosophique. La logique philosophique, ou en tout cas l'enseignement de la philosophie, n'a pas pour objet d'apprendre à répondre aux questions, mais d'apprendre à les poser. Et bien, je dirais que l'enseignement des arts appliqués, c'est un enseignement qui a pour objet de savoir poser des questions. Les designers et tous les créateurs je pense vous le diront, et ça nous a été démontré ce matin, : répondre à un problème et y répondre justement supposait la bonne question. Quand la question est bien posée, quasiment, la résolution est trouvée. Or, c'est bien une démarche philosophique, c'est la démarche qui se fonde sur la même structure mentale que celle de la philosophie. En conséquence : soyez d'une rigueur extrême, appelez-en à la fois à la construction, mais surtout à la logique du mot juste par rapport au sens. Cette attente de l'exigence du mot par rapport au sens, c'est exactement la même exigence que celle que nous avons nous en arts appliqués, quand nous essayons de trouver le vocabulaire plastique juste par rapport au sens à générer. Donc, le travail que vous faites lorsque vous êtes enseignant en français ou en philosophie, et bien sûr en mathématiques indépendamment des mathématiques c'est d'interactiver des outils cérébraux qui vont fonder des capacités logiques et des instruments opératoires que ces élèves au moment où ils seront appelés à rechercher, pourront récupérer, réinjecter presque implicitement, dans la création. Le travail sur le projet de création, de l'ordre de l'esthétique industrielle ou de la communication, engage le même processus. Les modalités sont différentes, quelquefois les stratégies de déclinaisons etc. sont différentes, mais le positionnement par rapport à un problème, le dégagement des questions qui va fonder un problème, c'est toujours la même stratégie, et si on ne sait pas faire ça, on ne pourra jamais faire des arts appliqués. Et vous comprenez le tout début de mon propos : 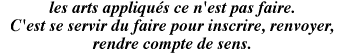 Si on ne sait pas analyser, si on n'est pas capable de conceptualiser à un autre niveau, on ne pourra jamais créer, créer dans le domaine de la création industrielle et artisanale, dans quelque domaine que ce soit d'ailleurs, c'est ma conviction. ALAIN LE QUERNEC Une réflexion. Comme vous l'avez vu, j'enseigne en collège, c'est-à-dire que j'enseigne avant les F12 qui se préparent à un métier. Je m'adresse aux élèves même dès la 6ème pour leur dire : mon but n'est pas de vous apprendre à dessiner, parce que fini les cours de 3ème, pour la quasi-totalité d'entre vous, vous n'allez plus dessiner, et j'essaie de vivre avec l'illusion que le temps que vous allez passer avec moi est un temps utile, qui vous sera utile au moins dans votre formation. L'important n'est pas d'apprendre à dessiner, l'important c'est d'apprendre à voir. Dès la 6ème j'essaie de leur expliquer cela, j'essaie de faire appel à l'intelligence du regard. 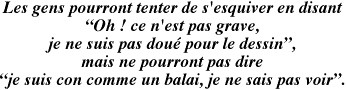 Tout le monde revendique l'intelligence du regard. Au niveau de la formation, dans le domaine des arts plastiques ou des arts appliqués, c'est un exercice pour apprendre à regarder la réalité des choses. En ce moment, en 4ème, je fais un cours sur la perspective, je dis bien aux élèves, le but n'est pas de savoir dessiner en perspective, et pourtant c'est un cours "arts traditionnels" ; la vieille méthode. Le but est d'apprendre un regard différent sur ce que l'on voit,. Avoir une perception, c'est ce que j'appelle l'intelligence du regard. Et là, je crois que la notion d'arts appliqués et d'arts plastiques n'existe pas tellement. |