|
|
| Intervention de Mme Anne Meyer |
||
| Je tiens à le préciser, je ne suis pas inspecteur d'arts plastiques, je suis inspecteur pour les arts appliqués, exclusivement. Cependant, je suis d'abord pédagogue, avant d'être une institutionnelle. Je pense que c'est important de faire le distinguo, même si l'objet de cette intervention, ou la question qui la traverse est : Sur le plan institutionnel, je crois qu'il est important de faire la distinction entre les formations arts plastiques et arts appliqués. Ça n'est pas un problème de fond, philosophique, puisque cette question je la déploierai ultérieurement, c'est une affaire de pure administration et de gestion à l'intérieur d'un Ministère qui s'appelle l'Éducation nationale. L'Éducation nationale donne deux types de formation. Une formation de culture générale dans le cadre des collèges et des lycées, et dans cette culture générale, une formation artistique. Dans l'auditoire, un certain nombre d'entre vous sont des professeurs d'arts plastiques. Donc, associés, participants et coopérants à cette formation générale d'une culture artistique, qui fait partie intégrante de la construction de la personne, et que l'on donne dans le cadre des collèges et des lycées. Les formations d'arts appliqués sont des formations artistiques, bien sûr, mais avec une autre finalité que celle de la création en soi. Même si cette création est toujours appelée à faire sens, c'est une création appliquée à la création industrielle et à la création artisanale. Les secteurs des formations d'arts appliqués sont donc très cadrés dans notre institution. Ce qu'on appelle les secteurs arts appliqués, du baccalauréat F12 et au-delà, la finalité des F12, c'est de s'orienter vers les BTS d'arts appliqués ; c'est-à-dire les différentes professions relevant du domaine du Design. Le tronc commun sera le Design de communication, mais à l'intérieur de ce Design de communication des spécificités sont développées : l'architecture intérieure, le stylisme, le textile, et en particulier évidemment, ce qu'on appelle aujourd'hui l'assistant à la création industrielle (autrefois l'esthétique industrielle). Donc, ce sont des formations avisées, professionnelles, et dont il est important de se dire qu'elles ne sont pas des formations de savoir faire. Pour insister un peu : on a créé un distinguo (je parle aux professeurs d'arts plastiques), un petit peu sommaire quant à ce que seraient les finalités justement de la formation artistique générale d'une part et des arts appliqués par ailleurs. 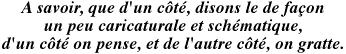 Franchement, je crois que l'intervention de Monsieur Le Quernec, et j'y suis très sensible, a pu vous démontrer combien pour un professionnel de la communication, l'objet même de l'image dans ce qu'il donne à voir, est d'abord la construction, l'élaboration d'une pensée et d'une réflexion mature. Dans le cas présent, à la fois une réflexion qui s'étaye sur l'expérience d'une vie je crois qu'il y a une dimension de vie dans ce qui fait la spécificité de cette réflexion et à la fois une culture, des références, et une certaine manière de voir le monde. Et je crois que c'est cette pensée sur le monde qui génère ce type d'image. Alors, il n'y a pas là seulement du savoir faire. Pour ce qui concerne la réalisation ou la production en tant que telles, alors là, effectivement, on va passer à l'acquisition de maîtrise. Ce que je veux dire par là, c'est que, si dans les arts appliqués, on acquiert des maîtrises, qu'il s'agisse des techniques industrielles ou qu'il s'agisse d'arts graphiques, ces maîtrises n'ont pour objet que de renforcer ou de servir le sens à signifier. Donc, encore une fois, la formation aux arts appliqués, n'est pas une formation où ne réussissent que ceux qui sont des manuels. Il est besoin d'une surdose intellectuelle pour réussir en arts appliqués. Je pense que c'est important de le redire, ça peut paraître évident pour certains, mais je pense que c'est important de le repréciser pour qu'il n'y ait pas de confusion. Si j'ai évoqué cette distinction un petit peu manichéenne chez certains, ou cette approche manichéenne de la situation, c'est qu'on se trompe en quelque sorte de cible. Au lieu de réfléchir sur ce qui fonde une véritable culture et les divergences à l'intérieur d'une culture, de ses lieux d'implication, on réagit en termes de système, on réagit en termes d'étiquette. Il n'est pas question de parler des personnes, mais des structures dans lesquelles elles se trouvent cadrées, effectivement. Mais je crois qu'il faut dire et redire, et ce moment de rencontre est un moment important dans ce sens, que ces corpus dans lesquels se trouvent enfermés ou enserrés, que ce soient des enseignants ou des corps d'inspecteurs, ne sont jamais que le corpus de pensées non éclairées. Pardonnez-moi d'être brutale, je crois que si on savait exactement ce que font les gens, je veux dire la finalité, les stratégies et les logistiques de la construction de leur maîtrise, les jugements ne pourraient pas être aussi catégoriques, et on pourrait peut-être, effectivement, par rapport à la question que pose ou que traverse votre intervention, réfléchir sur : est-ce que les arts appliqués c'est de l'art ? Des positions sont prises à ce sujet, on peut simplement signifier la chose suivante. Quand il y a création artistique en tant que telle, la seule différence avec les arts appliqués, c'est que le projet d'un plasticien est un projet personnel. C'est-à-dire que c'est un projet qu'il va fonder sur des logiques, sur sa sensibilité, sur des concepts, en tout cas c'est un positionnement personnel qui va définir sa trajectoire. Il y a des contraintes, il y a une rigueur de la pensée, je pense plasticienne, qui induit le créateur et le plasticien à générer un parcours sur des logiques qui sont les siennes. Seulement elles sont internes et elles sont individuelles, c'est ce qui fait la création artistique en tant que telle. |
| Les arts appliqués, je vais dire que c'est la même culture, c'est la même exigence, mais ce sont des contraintes qui ne sont pas les mêmes. Les contraintes viennent du dehors. Les arts appliqués ont une dimension du social, une relation au social, que n'a pas directement, si ce n'est dans sa dimension poétique, le champ du praticien des arts plastiques. Cependant, pour celui qui est dans l'engagement de la pratique appliquée, que ce soit en création industrielle ou en communication, il y a des moments où il y a quand même ce flottement : Qu'est-ce qui fait qu'une affiche n'est pas une oeuvre, et qu'une oeuvre est une oeuvre ? Qu'est-ce qui fait la différence de qualité ? Je crois qu'il y a ce flottement d'incertitude à un moment donné qui fait que quand il y a un projet, une intention maîtrisée dans la détermination à faire sens par des moyens qui sont, ou des moyens graphiques ou des moyens plastiques engagés par rapport à une sémantique de communication, et bien il y a oeuvre de toute manière. Il y a également flottement, quand on voit aujourd'hui un certain nombre de créateurs comme... bon, ce ne sont pas forcément des créateurs que j'apprécie, mais des cas médiatiques et des cas d'espèces comme lieux de repérages qui nous soient communs je pense à Stark par exemple. Où est la limite effectivement entre ce que serait de l'ordre simplement du Design chez Stark, et de l'ordre de la création personnelle ? C'est-à-dire d'une sorte de contre-réponses, qui seraient celles de Stark par rapport à la logique du Design ? On a des lieux de flottement qui nous obligent, avec beaucoup d'humilité, à revoir les certitudes, le cadrage descriptif et fermé d'un certain nombre de programmes institutionnels qui donnent des orientations et qui donnent des pistes. Je crois que c'est le rôle d'un programme de donner des orientations et de donner des pistes. Mais de là à s'enfermer à l'intérieur d'un programme ou d'une piste sur des certitudes qui seraient univoques, je crois que c'est vraiment une vision extrêmement réductrice, justement, du champ ouvert que propose la création artistique. |
| Or pour moi, ce que nous avons vu ce matin, le travail d'Alain le Quernec, ce travail est une oeuvre. Parce qu'il s'agit là, dans un cadre particulier de la plasticité, de renvoyer à des images qui font sens, et qui font sens pour plusieurs raisons. Elles font sens par rapport à la contrainte de communication qui les inscrit ou qui va les définir. Mais elles font sens beaucoup plus par les équivalences plastiques, par la qualité colorée, par tout ce que relève la sémantique du vocabulaire plastique. Alors dans cette production, où sont effectivement les produits spécifiquement arts appliqués qui seraient de l'ordre de la communication, et où sont les produits qui seraient des produits personnels et individuels ? Je crois vraiment que cette frontière, cette espèce de volonté encore une fois manichéenne, est extrêmement réductrice, et qu'elle nous oblige avec beaucoup d'humilité à réfléchir sur la définition que chacun doit donner aux objectifs d'éducation. Parce que les objectifs ne sont pas les mêmes à l'intérieur de cette institution. 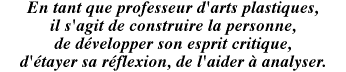 Mais moi, inspecteur d'arts appliqués, je fais appel à vous. Et je dis : nous, les élèves, on les prend après vous. Alors de même que nous nous sommes, j'allais dire contraints, ou en tout cas aiguillonnés pour forger des élèves en F12 qui vont être capables de rentrer à un niveau de formation en BTS avec cette fois une acquisition de performance et de maîtrise qui vont renforcer toutes les données d'investigation et de recherche que peuvent faire les professeurs de collèges ? Ils peuvent faire beaucoup, ils peuvent faire ce que fait monsieur Le Quernec, mais bien sûr, vous n'avez peut-être pas sa maîtrise pour faire de la communication. Mais je ne crois pas qu'on puisse lui reprocher de ne faire que de l'affiche. Et quand bien même, à partir de ce qui est fait là, quelque soit la modalité d'action, passent toujours, toujours, et toujours, les mêmes impulsions en termes d'objectif : ce sont la capacité réflexive, la capacité analytique, des incitations à développer l'esprit critique, à se saisir de problématique, à essayer de comprendre une question et la résumer en termes de problème. Comment est-ce que je peux conceptualiser ? C'est un grand mot, ce n'est pas le mot qu'on utilisera au collège. Mais en réalité, au fond, comment générer du concept ? Alors à ce niveau là, je crois que la démonstration a été superbe. Dans certaines images d'élèves, c'est quand même extraordinaire : on s'aperçoit qu'ils sont capables de réinjecter et de faire sens avec un esprit à la fois jouant de la dérision, du détournement, de la déclinaison de l'existant. Cet existant est ressaisi et repris en compte. Mais pour qu'il soit ressaisi et repris en compte et redéployé comme il l'est, il faut effectivement qu'il soit compris. Et je crois que le cours d'arts plastiques je ne dirais pas à quoi il est destiné, parce que je ne suis pas inspecteur dans cette discipline a une mission. A partir des outils, à partir des stratégies qui vous sont proposés, je crois que fondamentalement les grands objectifs de cette discipline, sont de construire l'esprit critique et la sensibilité. C'est-à-dire une capacité de lire le monde, d'une autre manière. L'enseignement général au collège dit bien ce qu'il veut dire, c'est un enseignement interactif. C'est-à-dire qu'on est dans des disciplines instrumentales. Le français, les mathématiques, les physiques, l'histoire, tout cela c'est du savoir, mais à la fois c'est du savoir qui apprend à manipuler du savoir, à se saisir de son propre champ de connaissance et à le construire. C'est bien pour cela que l'enseignement général au collège est un enseignement général. Et en quelque sorte, je crois que les arts plastiques sont coopérants de cette instrumentation de la personne, dans encore une fois, le déploiement de l'esprit critique en relation avec le champ sensible et en relation avec les références du champ artistique contemporain. D'où effectivement, une incitation dans vos pratiques à référer au champ contemporain. En arts appliqués, il ne s'agit pas d'atelier de pratique artistique. Il s'agit effectivement d'un certain nombre de mise à l'oeuvre de problématiques qui vont être posées et qui ont des objectifs à requérir. Pour la filière F12, il faut bien repréciser les choses, il s'agit bien d'une formation à la fois générale et technologique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons cette double mission en F12 de fonder les éléments d'une culture artistique, mais constamment articulée et toujours traversée des méthodologies et des réflexions qui vont conduire un projet de conception. C'est à dire qu'il ne s'agit pas en F12 de faire faire, mais il s'agit d'utiliser ce qui peut évoluer dans la capacité du faire, sur les motivations que sont le champ de l'investigation et de la réflexion. C'est donc la construction d'une certaine manière d'aborder la méthodologie de la création. Le F12 a cela pour finalité. S'il est très important et s'il est précieux en F12 de pouvoir faire intervenir des professionnels, à un moment donné du jugement critique d'un travail, ou à un moment donné en amont du positionnement de ce que vous appelez un cahier des charges, il est évident qu'en F12 il n'est pas question que le cahier des charges soit lourd et conséquent. Je crois qu'il n'est pas question en F12 que nous répondions à des "commandes", sauf si elles sont porteuses et prétextes à comprendre comment on conduit une recherche d'investigation par rapport aux contraintes imposées par le projet ou le domaine dans lesquels on est intégré. Si il y a là une intervention de professionnels ou des relations avec la profession elles sont toujours évidemment précieuses elles sont plutôt au niveau de la sensibilisation, et comme support susceptible de déployer une compréhension ou une avancée dans la compréhension des méthodologies de recherche. Encore une fois, le F12, c'est une base, c'est le socle qui va permettre à un élève, de pouvoir ensuite saisir les stratégies de recherche propres à un domaine, en acquisition de tous ces champs technologiques, de la manière la plus forte, la plus opportune et la plus immédiate, avec toutes les chances de réussir... En BTS, c'est différent. Nous pleurons sur le fait que nous n'avons que deux ans pour former en BTS, eu égard à ce temps extrêmement restreint, il faut que là, on soit très percutant. Il importe que l'on puisse s'appuyer sur le socle fondé par la formation des trois ans en F12 pour pouvoir à ce moment là, construire une formation qui va être constamment, quasiment en "alternance", en tout cas quasiment en alternance ou progressivement en adéquation, avec la confrontation à de véritables problèmes professionnels. Qu'est-il de mieux pour ce faire que de faire intervenir des professionnels dans les sections de BTS ? C'est prévu dans les textes. En BTS les professionnels sont appelés à intervenir pour une part du temps, en accord avec l'équipe pédagogique, bien sûr, et dans un travail d'équipe. Il ne s'agit pas que le professionnel fasse le cours, il s'agit que le professionnel intervienne par quota ou par module, en relation avec le professeur du bureau de création, de manière à pouvoir impulser des problèmes qui sont des vrais problèmes et à pouvoir, au moment où l'élève va être incité à développer à présenter ou analyser son travail, et opérer sur le travail de l'élève l'analyse d'un véritable regard professionnel, avec les vraies exigences professionnelles, en sachant très bien que l'élève n'aura pas pu répondre au top niveau. Mais au moins, les vraies questions seront posées, les vrais lieux de l'analyse ou du questionnement seront posés, et les vrais lieux de l'analyse et de la réflexion en final sur l'analyse critique du travail seront posés. Et là, les professionnels sont pour nous totalement incontournables. C'est peut-être effectivement, en BTS que vous pouvez avoir à répondre à des "commandes", relations toujours privilégiées avec les entreprises ou les industries locales, de manière à pouvoir confronter vos élèves à des situations quasiment professionnelles. C'est-à-dire, une vraie confrontation avec le terrain de la profession. Concernant les pratiques ou les stratégies à mettre en oeuvre, relevant pour ce BTS particulièrement de l'interaction du champ des arts plastiques et du bureau de création, je voudrais définir le champ de l'expression plastique comme lieu de traversée de l'ensemble des formations d'arts appliqués. Ça s'appelle l'expression plastique. Ça me gêne toujours un petit peu l'expression plastique, parce ça a un petit côté comme ça, "je m'exprime, plastiquement", bon ! Le travail de l'expression plastique, ou de la pratique plastique, je préfère, c'est par la stratégie de la mise en situation d'expression personnelle, le lieu où se trouve mise à l'oeuvre une confrontation de l'élève avec tous les paramètres d'un langage particulier qui s'appelle le langage plastique. C'est-à-dire que le professeur a une tâche bien spécifique. Par des stratégies de la manipulation, de l'exploration, de l'investigation, c'est-à-dire sur des projets ouverts, il s'agit pour l'enseignant d'établir tout de même dés le départ, des objectifs qui vont permettre à l'élève de pouvoir, tout de suite, à partir de ces pratiques ou sur ces pratiques ou à l'aide de ces pratiques, comprendre, connaître, mettre en interférence, tous les éléments qui sont à la disposition de ce vocabulaire très particulier qui est le vocabulaire d'un langage plastique. C'est-à-dire la mise en relation de formes, de couleurs, d'organisation d'espace qui font du sens. Le cours d'expression plastique ne peut pas être dénué de la question du sens. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire des choses là encore, mais il est question de conduire une action impulsée, soit par une problématique soit par un concept, et qui va permettre à l'élève, ce faisant, de comprendre ce qui se génère quand j'oeuvre. Quand j'agis, quand je trace, quand je raisonne d'une certaine vision du monde ou d'une certaine résonance à une question par des moyens plastiques, je fais du sens. Et fondamentalement, si l'expression plastique a un fondement incontournable dans le cadre des formations d'arts appliqués, c'est bien là. Ce langage particulier d'un vocabulaire spécifique a pour objet de générer du sens , et la mise en pratique de ce vocabulaire permet à l'élève en constance d'être confronté au sens qu'il génère, et au sens qu'il va générer dans sa pratique plastique, mais également au sens, par conséquent, qu'il va générer dans sa production appliquée. Et c'est bien cette interaction là, de la découverte d'un vocabulaire qui ne peut être efficient, même au niveau de l'expression personnelle, que dans sa propriété à définir du sens, et le sens que je veux en particulier. Et là il y a expression. |