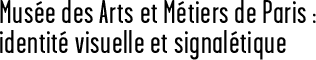|
|
|
| Décembre 1995 : un appel d'offres
international concernant la signalétique du musée des
arts et métiers fut lancé par la Mission Interministérielle
des Grands Travaux. Celle-ci, sous l'autorité du Premier Ministre,
suivait déjà la rénovation du musée à
la suite d'un grand concours architectural initié en 1992 dans
le cadre des Grands Travaux proposés par François Mitterrand,
alors Président de la République. |
|
De janvier à mars 1996, lauréats du premier tour de
la consultation où cinq agences, parmi plusieurs dizaines,
avaient été retenues pour présenter un projet
signalétique pour le musée, nous nous mîmes au
travail. La première étape consista à lire, et
surtout à comprendre, le très volumineux dossier qui
nous avait été remis par le maître d'ouvrage.
Pendant trois mois, les réunions se succédèrent.
Réflexions, échanges, esquisses... aboutirent à
un projet signalétique dans lequel nous avions mis tous nos
rêves : couleurs, images, typographie composaient un ensemble
que nous voulions clair, cohérent mais aussi original, coloré
et surtout poétique, à l'image de ce musée que
l'esprit de Jules Verne semblait avoir inspiré. Le jury composé
de scientifiques, de conservateurs du musée, de personnalités
nommées par le maître d'ouvrage, sans oublier les architectes
de la rénovation, retint deux équipes de graphistes.
Nous étions l'une d'entre elles. Après la réalisation
de prototypes en taille réelle et plusieurs entrevues au cours
desquelles nous devions défendre notre projet, nous fûmes
déclarés titulaires du marché de signalétique
du Musée des arts et métiers.
Début 1997, après de multiples visites de chantier en
compagnie de la directrice et des conservateurs du musée, nous
pûmes véritablement commencer à travailler. Engagés
pour la première fois dans un projet d'une telle ampleur, nous
pûmes mesurer l'écart abyssal qui existe entre une simple
commande ponctuelle faite à des graphistes et la conception
globale d'une signalétique d'un grand musée, véritable
scénographie des images et des mots. Car, si l'aspect formel
revêt, bien entendu, une importance capitale, les préliminaires
intellectuels et conceptuels sont capitaux pour forger une véritable
identité graphique tridimensionnelle. |
|
| La signalétique muséographique
doit poursuivre quelques buts essentiels : accompagner le visiteur
dans une découverte à la fois passionnante, scientifique
et fluide des collections, rendre aisément lisibles et surtout
intelligibles les textes contenus dans les supports signalétiques
placés à côté des objets du musée
mais aussi s'intégrer le plus justement et le plus esthétiquement
possible à l'architecture des lieux et à la muséographie
proposée. |
|
Ces trois années qui précédèrent
l'ouverture du musée furent consacrées à la conception,
à la réalisation et au suivi de fabrication de l'ensemble
des supports signalétiques qui jalonnent désormais le
parcours du visiteur. Tests des panneaux en taille réelle,
implantation de l'ensemble des supports, recherches sur les matériaux
envisagés pour leur construction, réunions hebdomadaires
sur le lieu du chantier, contrôle de lisibilité par des
commissions compétentes... rythmèrent la vie de l'atelier
pendant toute la durée du projet. Le plus difficile, parfois,
fut de convaincre nos interlocuteurs du musée et de la maîtrise
d'ouvrage de la pertinence de nos propositions et de la qualité
du projet global que nous envisagions. En règle générale,
la signalétique des musées ou d'autres institutions
décline plutôt une gamme
assez large de gris ou une monochromie plutôt terne tandis que
nous proposions une symphonie de couleurs accordée à
la variété des objets et aux
teintes retenues pour les murs des différentes salles du musée.
De plus, nous avions pris le parti de caractériser chaque domaine
du musée (instrument scientifique, matériaux, transports...)
par une image et par une trame le symbolisant. La signalétique
devenait une image, dépassant le cadre habituel de fonctionnalité
qu'on lui attribue généralement.
Les débats furent parfois vifs d'autant que l'enjeu paraissait
de taille à tous les protagonistes : réussir un
musée scientifique accessible à tous, combinant savoir
et esthétique, technique et poésie. Un vrai musée
des arts et métiers en somme.
Courant 1999, nous fûmes également chargés de
la création du logotype du musée. Après quelques
tentatives infructueuses et de nombreuses semaines de travail, nous
parvîmes à synthétiser un dimanche après-midi,
ce qui, pour nous, reflétait le mieux le Musée des arts
et métiers : un "M" institutionnel, une évocation
de l'architecture intérieure et l'objet symbolique du musée,
le pendule de Foucault si justement décrit par Umberto Ecco
dans son ouvrage éponyme.
Les derniers mois furent consacrés à suivre la fabrication
des supports signalétiques, à déterminer les
derniers réglages en matière de couleurs, matériaux
et à assister à l'impression des panneaux en sérigraphie.
Les panneaux furent posés, implantés, fixés...
Cela prit quelques temps et en mars 2000, le musée ouvrit.
Notre mission était accomplie. |
|
|
MICHEL BOUVET |
|
|
L'équipe
était
constituée de :
Michel Bouvet,
Agnès Pichois,
Constanza Matteucci, Caroline Pauchant,
Agnès Sturnich graphistes,
et du précieux conseil technique en signalétique
d'Alain Verdillon
(Marcal Signalétique)
et en scénographie de Manuela Manzini.
Merci à Valérie Durand et Lyonel Maillot |
|