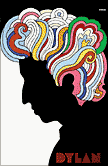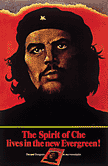|
|
| Affiches psychédéliques aux USA dans les années 70 |
| Les affiches présentées sont celles de la génération née de l'explosion démographique de l'après-guerre : le baby-boom. Si dans tout le monde occidental, les jeunes se révoltent contre l'ordre établi et les manières de penser de leurs parents, le mouvement qui se développe aux Etats-Unis est d'une richesse et d'une amplitude qui n'a rien de comparable avec l'Europe. À titre d'exemple, le soulèvement de mai 68, pour important qu'il soit dans l'histoire de la société française, ne peut être comparé à la violence du mouvement américain : il faut dire qu'alors que la France est sortie de la guerre d'Algérie, les Etats-Unis entrent dans la guerre du Vietnam. Dans le même temps, les derniers coups de boutoirs sont donnés à la ségrégation raciale encore solidement installée dans de nombreux états. Les affrontements qui explosent sur tous les campus du pays font des centaines de morts et concernent des centaines de milliers de militants. C'est aussi d'Amérique que souffle désormais la culture. La même année 1954 voit le premier enregistrement d'Elvis Presley et la première proclamation de Howl, texte fondateur de la poésie "beat" par Allen Ginsberg. Ainsi, de la "beat generation" naissent les hippies de la côte ouest et les yippies de Abbie Hoffmann et Jerry Rubin, tout comme des groupuscules d'extrême gauche - on peut citer les S.D.S (Students for Democratic Society). |
 |
 |
 |
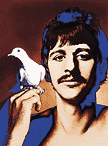 |
||||
| RICHARD AVEDON, 1967 John Lennon, Paul Mc Cartney, Georges Harrison, Ringo Star, photographies solarisées. Ces quatre icônes parurent à l'origine dans Look Magazine le 9 janvier 1968. |
|||||||
| Tous se regroupent dans ce qu'on appelle "The Movement", sur fond de musiques de Dylan, des Beatles, des Stones qui envahissent l'Amérique en 1964 et dans les fumées de marijuana, les vapeurs de LSD qu'on vient à peine d'interdire, avec pour points culminants les émeutes de la contre-convention de Chigago en 1968 et le gigantesque concert de Woodstock en août 1969. Cette véritable révolution politique et culturelle correspond à un âge d'or du "poster", cette version non commerciale de l'affiche qui envahit les chambres d'étudiants mais aussi les murs. Là aussi, c'est une nouvelle génération qui s'exprime que ce soit dans le bric-à-brac psychédélique des "aquarian age posters" de la côte ouest signés Moscoso, Mouse, Kelley et autres Sheldon, toutes créées sous influence, ou les premiers dessins de Crumb. Des images emblématiques naissent comme le portrait du Che, tué en octobre 67, ou, plus artistiquement, les Beatles recoloriés par Avedon ou Dylan par Milton Glaser qui vient de créer à New York le Push Pin Studio. |
|
|||||||||||||||||
À côté de ces désormais grands classiques, qui sont devenus des images cultes, des centaines d'affiches farouchement militantes ou jubilatoirement défoncées sortent d'une multitude d'ateliers et de petites maisons d'édition.
Ce sont quelques-uns de ces documents dont beaucoup ont aujourd'hui la rareté de l'éphémère qui sont présentés ici. Le puritanisme a fait que, souvent par simple autocensure, elles n'ont pratiquement jamais été exposées en public — mais quel intérêt y a t-il à cacher une réalité qui appartient désormais à l'histoire ? C'est cette lacune que, dans sa diversité, l'exposition "Sex, drugs and rock'n roll" cherche à combler.
Alain Weill |