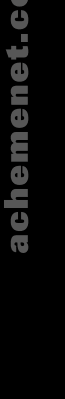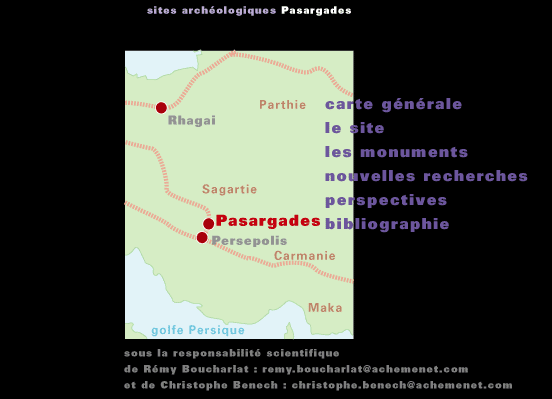|
Pasargades, première capitale perse fondée
par Cyrus au milieu du VIe siècle avant J.-C., perd son rôle
prépondérant à partir de Darius, vers 520, lorsque
Persépolis et d’autres villes réparties dans un Empire
devenu immense (Suse, Ecbatane, Babylone) lui sont préférées.
Pasargades reste un centre économique actif, comme en témoignent
plusieurs tablettes de Persépolis, mais sa fonction est difficile
à définir, sans doute un haut-lieu dynastique et peut-être
un centre religieux. Les textes et les données archéologiques
ne permettent pas d’être plus précis, d’autant
plus que la part respective qui revient à Cyrus dans les constructions
et celle de Darius ne fait l’unanimité parmi les chercheurs ;
ainsi les courtes inscriptions gravées sur les piliers de deux
palais portant « Cyrus est le grand roi, l’Achéménide »
et « Je suis Cyrus, le roi, l’Achéménide »
sont, pour les uns l’œuvre de Cyrus, pour les autres un ajout
de Darius. Dans ce dernier cas, on aurait la preuve que Pasargades gardait
une signification importante pour ce successeur de Cyrus.
Le site 1/1 À 70 km au nord de Persépolis, Pasargades
occupe la partie méridionale d’une grande plaine à
1 900 m d’altitude. Si elle n’est aussi bien située
que Persépolis puis Shiraz sur les grandes voies de communication,
elle est cependant sur le tracé d’une route importante entre
Shiraz dans les montagnes et le Plateau iranien en direction de Isfahan
au nord, Yazd et Kerman vers le nord-est. La route ancienne, directe,
depuis le sud traverse une gorge dont certains secteurs ont été
aménagés à une époque indéterminée.
La zone archéologique occupe plus de 200 hectares, depuis une
plateforme construite sur une colline, flanquée d’une enceinte
au nord, jusqu’au tombeau de Cyrus au sud. La plus grande partie
du site est un espace presque plan, traversé du nord au sud par
une rivière aujourd’hui disparue qui prend naissance sur
la rivière Pulvar ; un autre cours d’eau borde le site
à l’ouest. Quelle que soit la part prise par les hommes
pour aménager le site, Pasargades bénéficie de
bonnes conditions naturelles par son climat, ses ressources en eau et
la qualité des terres arables.
Les monuments 1/5 Comparé à Persépolis, le site
de Pasargades semble vide, au point que depuis un siècle, on
a voulu y voir une capitale plus proche du camp royal qu’entretenaient
les rois safavides et qajars jusqu’au XIXe siècle, que d’une
véritable ville construite. Le petit nombre de monuments visibles
en surface a renforcé l’image que les archéologues
avaient à l’esprit, celle d’un campement, capitale
de tentes d’un empire naissant. La réalité de cette
image, qui reste à démontrer, est l’un des objectifs
du nouveau projet de recherche sur Pasargades.
Les principaux monuments en pierre, une demi-douzaine ont été
reconnus et sondés par E. Herzfeld en 1928. Les fouilles ont
été poursuivies par A. Sami en 1949-1955, complétés
(1961-1963) et soigneusement publiées (1978) par D. Stronach.
D’autres traces, extérieures aux constructions conservées
en surface, ont été relevées par Herzfeld, mais
n’ont pas été exploitées jusqu’à
présent.
La plateforme et l’enceinte polygonale 2/5 Cyrus a fait construire
les murs de soutènement de la plateforme en bel appareil à
bossage, technique apparue dans des cités grecques d’Asie
Mineure hellénisée quelques décennies plus tôt
seulement. Après sa victoire sur Crésus, le roi perse
avait fait venir des artisans ioniens dans le Fars.
Les constructions portées par cette terrasse sont en briques
crues ; elles sont postérieures à Cyrus et ne paraissent
pas correspondre au plan d’un palais. Seule cette partie, la plus
facile à défendre sur le site, sera réoccupée
au début de l’époque séleucide, puis encore
à l’époque islamique ancienne.
Cette construction est le point dominant d’une enceinte en briques
crues qui couronne un arc de collines au nord et franchit deux dépressions
entre celles-ci. L’espace protégé, plus de 20 ha,
est resté inexploré.
Le jardin royal 3/5 À mi-chemin entre le tombeau de Cyrus au
sud et la plateforme au nord, l’ensemble des cinq constructions
à colonnes organisées autour d’un jardin, est le
quartier royal officiel. Le centre en est occupé par un jardin
de près de 3 hectares, peut-être divisé en quatre,
en quelque sorte l’ancêtre du chahar bagh persan (« quatre
jardins »).
L’aire aménagée en parc est certainement plus vaste,
englobant les deux constructions hypostyles à portiques et deux
pavillons également hypostyles jusqu’à la Porte monumentale
à l’est, au-delà du pont antique qui franchit la
rivière aujourd’hui asséchée.
Une partie de la décoration sculptée de ces bâtiments
a survécu, mais les chapiteaux en pierre et les éléments
peints, entrevus par Herzfeld, ne sont plus visibles aujourd’hui.
Technique de la taille de la pierre et forme des bases de colonnes montrent
ici encore l’intervention d’artisans ioniens. Le plan de ces
bâtiments est perse, héritier d’une tradition iranienne
attestée dans le Zagros.
Le tombeau de Cyrus 4/5 Cette belle construction en pierre, en forme
de maison sur sept degrés (13,35 x 12,30 m à la base et
11,10 m de hauteur) est la plus connue de Pasargades. Sa destination,
longtemps disputée, ne fait plus guère de doute, d’après
les données archéologiques et les sources textuelles ;
elle est la tombe de Cyrus (+529). Elle apparaît aujourd’hui
isolée dans un terrain dénudé, mais les sources
classiques disent clairement qu’elle était environnée
de verdure, au point qu’on peut se demander si elle n’était
pas intégrée dans le parc royal, dont le jardin central
est distant d’un kilomètre.
Techniques de construction et détails architecturaux du tombeau
évoquent l’art hellénisé d’Asie mineure.
Mais dès le VIe siècle apparaît un mouvement inverse ;
ce monument a peut-être inspiré un satrape ou un personnage
important d’Asie mineure occidentale, qui a fait ériger
à Sardes un tombeau comparable à celui de Cyrus.
Les autres constructions 5/5 L’énigmatique tour de 7 m de
côté, appelée plus tard Zendan-i Solaiman, est distante
de plus de 200 m du jardin et de 400 m de la plateforme ; tombe,
temple, temple du feu, dépôt d’archives ou des symboles
de la royauté, elle a résisté jusqu’ici à
l’interprétation ; il n’est pas sôr qu’elle
soit isolée d’autres constructions qui restent à
découvrir.
À 1 km au nord-ouest de cette tour, les deux cubes en pierre
et les traces d’une grande enceinte rectangulaire qui les protège
apparaissent encore plus isolés du reste du site central, dont
ils sont séparés par une haute colline. Ces « autels »
ont également donné lieu à bien des hypothèses
parmi lesquelles celles d’autels doubles ou bien d’un autel
du feu et d’une estrade pour le roi officiant. La religion des
Achéménides est si mal connue qu’elle autorise toutes
les interprétations, depuis un mazdéisme primitif jusqu’au
zoroastrisme véritable, tel qu’on le connaît des siècles
plus tard.
Nouvelles recherches.
1/6 L’ensemble du site fait l’objet d’un nouveau programme
franco-iranien sous l’égide de l’Organisation du Patrimoine
culturel national d’Iran, soutenu par le Ministère des Affaires
Étrangères et le CNRS (France).
Pasargades apparaît au visiteur comme un site pauvre en constructions ;
on comprend que son aspect ait suscité l’hypothèse
d’un vaste camp, ce qui satisfaisait à une certaine image
de la mise en place de l’Empire achéménide, né
de l’ascension rapide d’un roi, à l’origine petit
chef de tribu, conservant son mode de vie de pasteur et de nomade.
C’est l’organisation de la capitale de l’empire avant
Darius que le nouveau programme a commencé d’étudier
en 1999. Est-ce plutôt un camp royal aménagé autour
de quelques monuments symboliques, ou bien une véritable ville
construite dont la plupart des éléments ne seraient plus
visibles ?
2/6 Même dans l’hypothèse d’un camp, celui-ci
doit avoir laissé des traces d’aménagement, marquées
en surface et surtout décelables par différentes techniques
d’investigation.
Ces traces sont étudiées à partir des observations
et relevés anciens, de l’étude topographique minutieuse,
à partir d’un nouveau relevé effectué par
l’Organisation du Patrimoine culturel iranien en 1999 (sur Autocad),
des photos aériennes anciennes (E.F. Schmidt 1935) et plus récentes
(1969 et 1989) et d’une campagne photographique par cerf-volant,
et surtout à partir de prospections géophysiques (magnétiques
surtout mais aussi électriques).
Chance particulière, Pasargades n’a pas connu d’occupations
antérieures, ni postérieures, sauf en de rares secteurs
(plateforme et tombeau de Cyrus) : la lecture des cartes de prospection
magnétique ne devraient faire apparaître que des structures
achéménides ;
Le projet porte sur une reconnaissance du site au sens large, s’étendant
au nord depuis l’origine du canal au nord de Seh Asiab et le village
de Morghab jusqu’à l’aval du Tang-i Bulaghi au sud
(environ 25 km2).
Les opérations 3/6 Le relevé topographique s’étend
au-delà de la zone actuellement protégée, vers
le nord (enceinte polygonale), le nord-ouest dans la zone de collines
entre celle-ci et l’enceinte sacrée et au-delà, ainsi
qu’à l’est du jardin royal ; ces secteurs sont
largement cultivés aujourd’hui.
La prospection géophysique porte sur plus de 500 ha, selon une
procédure à adapter au terrain, en particulier dans les
zones cultivées. Les premiers résultats (méthode
magnétique, quelques tests de résistivité électrique)
dans la zone des palais et du Zendan, comme dans l’enceinte polygonale,
ont été très fructueux ; ils ont aussi permis
d’étalonner les réponses à partir des réponses
donnés par des éléments anthropiques connus.
La prospection archéologique couvre un territoire élargi
collines situées au nord de la zone protégée jusqu’à
Tall-i Hazrat Ya’qub. Plusieurs d’entre elles portent à
leur sommet des aménagements en pierres, parfois modestes, non
datées, qui doivent être relevées. L’emamzadeh
du Hazrat Ya’qub en particulier contient des éléments
architecturaux en pierre, travaillés comme ceux des monuments
de Pasargades même.
Premiers résultats des prospections magnétiques 4/6 Les
constructions conservées sont en pierre, mais d’autres matériaux
étaient mis en œuvre, comme la brique crue et la terre,
comme l’ont montré les fouilles. La prospection magnétique
nécessite donc la création d’un référentiel
établi à partir des constructions connues ; elles
permettent d’étalonner les mesures, donnant ainsi une indication
sur les éventuels vestiges anciens et leur nature.
L’un des trois secteurs choisis est le jardin royal, prenant comme
référence les canaux en pierre. Les 3 ha couverts dans
le prolongement du quadrilatère (chahar bagh) au sud et hors
de celui-ci à l’est sont traversés par des alignements
orientés comme les canaux et les constructions. Il est probable
que le réseau de canaux s’étend jusqu’à
la rivière. De petites structures isolées apparaissent
également dans l’axe du Palais S. La rive gauche jusqu’à
la Porte R et un mur d’enceinte (?) n’a pas encore été
explorée. Au sud du jardin, des alignements se laissent lire
entre le Palais S et un monticule de forme quadrangulaire déjà
repéré par Herzfeld.
5/6 Le second secteur prospecté est à l’est de la
tour Zendan-i Sulaiman oò relevés de Herzfeld et photos
aériennes montrent un tepe de forme quadrangulaire et des alignements.
Selon la prospection, le tepe recouvre une construction de 45 m de côté
environ dont les murs extérieurs sont en pierre. Les angles sont
en forme de tours saillantes et l’intérieur est divisé
par des alignements. A l’extérieur à l’est,
la prospection confirme des longs alignements.
Le troisième secteur, à l’extérieur de la
zone archéologique protégée, couvre 1,25 ha dans
l’enceinte polygonale, qu’un sondage a identifié comme
un épais mur en briques crues. la prospection confirme l’existence
de cette masse de terre, mais ajoute à l’intérieur,
sur la pente vers le fond plat de la dépression de nombreuses
formes quadrangulaires juxtaposées. Par contraste, le fond plat,
aujourd’hui cultivé, paraît vide de tout aménagement.
L’exploration du Tang-i Bulaghi 6/6 Toutes les eaux de la de la
plaine de Morghab convergent au sud du tombeau de Cyrus et s’engouffrent
dans un défilé, étroit au départ, qui s’élargit
après 4 kilomètres jusqu’à son débouché
12 km plus loin, près de Sivand, dans la vallée principale
qui conduit à Persépolis.
« Route royale » rupestre sur la rive droite sur
quelque 500 m en plusieurs tronçons, canal rupestre sur la rive
gauche sont représentés par des aménagements encore
bien visibles aujourd’hui. Ces travaux dans la roche, achéménides
ou bien plus récents, suscitent bien des interrogations :
faible largeur de la « voie », 1,70 m au maximum,
mais souvent 1 m, parfois réduite à 0,50 m, comme on l’a
observé en 1999 ; forts pendages du « canal »
tantôt vers l’amont, tantôt vers l’aval, nombreuses
sections inachevées. En aval de la gorge, dans la partie élargie
de la vallée, les traces de travaux rupestres sont remplacées
par une sorte de chaussée ou mur, construit en pierres, large
de 2 m, longeant la rivière et compensant les déclivités
et les accidents de terrain par une maçonnerie à peu près
horizontale.
Parties rupestres et parties construites représentent ensemble
un gros investissement de travail dont la fonction et la date restent
à déterminer. Dans une première phase, les vestiges
doivent être relevés en détail, puis assemblés
en plan et en section.
Perspectives 1/1 Les prospections, préliminaires valident l’emploi
de la méthode magnétique qui, le cas échéant,
est complétée ou confirmée par la méthode
électrique, pour distinguer les structures en pierre de celles
en briques ou terre (tests dans le jardin royal). La superficie prospectée
(7,25 ha sur plus de 200) a valeur de test. Elle fait apparaître,
avant toute interprétation, l’existence en plusieurs secteurs
d’aménagements en pierre dont rien, ou de micro-reliefs,
n’apparaissait en surface : quelle que soit leur extension,
leur plan et leur fonction, elles démontrent déjà
la présence d’autres constructions que celles que l’on
connaissait ; elles sont parfois importantes et surtout elles remettent
certains bâtiments isolés dans un ensemble construit plus
vaste et plus complexe.
La poursuite du programme dans ces secteurs, et surtout au-delà
de la zone protégée, devrait modifier considérablement
l’image de la capitale de Cyrus.
Les mêmes méthodes appliquées dans toutes les directions
vers l’extérieur devraient atteindre des limites, c’est-à-dire
mettre en évidence un contraste entre une zone périphérique
aménagée et les environs de la ville de Pasargades qui
auraient supporté des activités agricoles, élevage
et agriculture, dont les traces seront très ténues ou
invisibles.
Légendes Pasargades
001 Le tombeau de Cyrus dans son état actuel 002 Le tombeau de
Cyrus en 1840 (dessin de Flandin et Coste) 003 Plan schématique
de Pasargades localisant les monuments visibles en surface.
004 La tour appelée depuis le Moyen-Age Zendan-i Solaiman (« la
prison de Salomon ») très semblable à celle
de Naqsh-i Rusqtam. La fonction de l’une et l’autre reste
inconnue.
005 Le palais P appelé aussi Palais résidentiel est une
salle hypostyle rectangulaire à deux poortiques très débordants.
006 Le palais S appelé aussi Palais d’audience, salle hypostyle
à portiques 007 Plateforme appelée Takht-i Solaiman, construction
en pierres appareillées, de l’époque de Cyrus 008
Détail de l’appareil du Takht-i Solaiman. Les cavités
correspondent au pillage des crampons métalliques pour en récupérer
le plomb.
009 L’angle de la plateforme Takht-i Solaiman 010 Lesdeux « autels »
en pierre de Pasargades, tous deux monolithiques.
011 Le centre du site oò apparaissent des micro-reliefs rectilignes.
Ils peuvent correspondre à des structures antiques ou des murs
bordant des champs modernes.
012 Entre le Tall-i Takht et le jardin royal, le lit de la rivière
ancienne est encore lisible.
013 Le jardin royal est marqué par un réseau de canaux
en pierres appareillées.
014 Détail d’un bassin disposé tous les 14 m sur
le réseau de caneaux 015 Relevé du site et des environs
en 1938 par E. Herzfeld et Friedrich Krefter.
016 Prospection magnétique avec un gradiomètre au cesium
dans la zone du jardin royal.
017 L’image géophysique complète le réseau
de canaux dans le jardin royal. D’autres structures restent à
interpréter.
018 L’image géophysique près de la tour du Zendan-i
Solaiman (à gauche) fait apparaître le plan d’une
grande construction aux angles renforcés de tours.
(À venir) Plan de la partie centrale du site. Les constructions
sont disposées dans un jardin ou parc.
(À venir) Photo aérienne (E.F. Schmidt 1935) montrant
le tracé de l’enceinte polygonale, en briques crues selon
un sondage, qui s’accroche à la plateforme du Takht-i Solaiman.
(À venir) Photo aérienne (E.F. Schmidt 1935) sur la partie
centrale et méridionale du site en direction de la gorge Tang-i
Bulaghi.
Pasargades • monuments • nouvelles
recherches • perspectives
Présentation générale
Pasargades, première capitale perse fondée par Cyrus au
milieu du VIe siècle avant J.-C., perd son rôle prépondérant
à partir de Darius, vers 520, lorsque Persépolis et d’autres
villes réparties dans un Empire devenu immense (Suse, Ecbatane,
Babylone) lui sont préférées.
Pasargades reste un centre économique actif, comme en témoignent
plusieurs tablettes de Persépolis, mais sa fonction est difficile
à définir, sans doute un haut lieu dynastique et peut-être
un centre religieux. Les textes et les données archéologiques
ne permettent pas d’être plus précis, d’autant
plus que la part respective qui revient à Cyrus dans les constructions
et celle de Darius ne fait l’unanimité parmi les chercheurs ;
ainsi les courtes inscriptions gravées sur les piliers de deux
palais portant « Cyrus est le grand roi, l’Achéménide »
et « Je suis Cyrus, le roi, l’Achéménide »
sont, pour les uns l’œuvre de Cyrus, pour les autres un ajout
de Darius. Dans ce dernier cas, on aurait la preuve que Pasargades gardait
une signification importante pour ce successeur de Cyrus.
Pasargades • monuments • nouvelles
recherches • perspectives
Le site 1/1 À 70 km au nord de Persépolis, Pasargades
occupe la partie méridionale d’une grande plaine à
1 900 m d’altitude. Si elle n’est aussi bien située
que Persépolis puis Shiraz sur les grandes voies de communication,
elle est cependant sur le tracé d’une route importante entre
Shiraz dans les montagnes et le Plateau iranien en direction de Isfahan
au nord, Yazd et Kerman vers le nord-est. La route ancienne, directe,
depuis le sud traverse une gorge dont certains secteurs ont été
aménagés à une époque indéterminée.
La zone archéologique occupe plus de 200 hectares, depuis une
plateforme construite sur une colline, flanquée d’une enceinte
au nord, jusqu’au tombeau de Cyrus au sud. La plus grande partie
du site est un espace presque plan, traversé du nord au sud par
une rivière aujourd’hui disparue qui prend naissance sur
la rivière Pulvar ; un autre cours d’eau borde le site
à l’ouest. Quelle que soit la part prise par les hommes
pour aménager le site, Pasargades bénéficie de
bonnes conditions naturelles par son climat, ses ressources en eau et
la qualité des terres arables.
Pasargades • monuments • nouvelles
recherches • perspectives
La plate-forme et l’enceinte polygonale
Comparé à Persépolis, le site de Pasargades semble
vide, au point que depuis un siècle, oná a voulu y voir une capitale
plus proche du camp royal qu’entretenaient les rois safavides et
qajars jusqu’au XIXe siècle, que d’une véritable
ville construite. Le petit nombre de monuments visibles en surface a
renforcé l’image que les archéologues avaient à
l’esprit, celle d’un campement, capitale de tentes d’un
empire naissant. La réalité de cette image, qui reste
à démontrer, est l’un des objectifs du nouveau projet
de recherche sur Pasargades.
Les principaux monuments en pierre, une demi-douzaine ont été
reconnus et sondés par E. Herzfeld en 1928. Les fouilles ont
été poursuivies par A. Sami en 1949-1955, complétés
(1961-1963) et soigneusement publiées (1978) par D. Stronach.
D’autres traces, extérieures aux constructions conservées
en surface, ont été relevées par Herzfeld, mais
n’ont pas été exploitées jusqu’à
présent.
Pasargades • monuments • nouvelles
recherches • perspectives
La plateforme et l’enceinte polygonale 2/5
Cyrus a fait construire les murs de soutènement de la plateforme
en bel appareil à bossage, technique apparue dans des cités
grecques d’Asie Mineure hellénisée quelques décennies
plus tôt seulement. Après sa victoire sur Crésus,
le roi perse avait fait venir des artisans ioniens dans le Fars.
Les constructions portées par cette terrasse sont en briques
crues ; elles sont postérieures à Cyrus et ne paraissent
pas correspondre au plan d’un palais. Seule cette partie, la plus
facile à défendre sur le site, sera réoccupée
au début de l’époque séleucide, puis encore
à l’époque islamique ancienne.
Cette construction est le point dominant d’une enceinte en briques
crues qui couronne un arc de collines au nord et franchit deux dépressions
entre celles-ci. L’espace protégé, plus de 20 ha,
est resté inexploré.
Pasargades • monuments • nouvelles
recherches • perspectives
Le jardin royal 3/5 À mi-chemin entre le tombeau de Cyrus au
sud et la plateforme au nord, l’ensemble des cinq constructions
à colonnes organisées autour d’un jardin, est le
quartier royal officiel. Le centre en est occupé par un jardin
de près de 3 hectares, peut-être divisé en quatre
parties marquées par des canaux, en quelque sorte l’ancêtre
du chahar bagh persan (« quatre jardins »).
L’aire aménagée en parc est certainement plus vaste,
englobant les deux constructions hypostyles à portiques et deux
pavillons également hypostyles jusqu’à la Porte monumentale
à l’est, au-delà du pont antique qui franchit la
rivière aujourd’hui asséchée.
Une partie de la décoration sculptée de ces bâtiments
a survécu, mais les chapiteaux en pierre et les éléments
peints, entrevus par Herzfeld, ne sont plus visibles aujourd’hui.
Technique de la taille de la pierre et forme des bases de colonnes montrent
ici encore l’intervention d’artisans ioniens. Le plan de ces
bâtiments est perse, héritier d’une tradition iranienne
attestée dans le Zagros.
Pasargades • monuments • nouvelles
recherches • perspectives
Le tombeau de Cyrus 4/5 Cette belle construction en pierre, en forme
de maison sur sept degrés (13,35 x 12,30 m à la base et
11,10 m de hauteur) est la plus connue de Pasargades. Sa destination,
longtemps disputée, ne fait plus guère de doute, d’après
les données archéologiques et les sources textuelles ;
elle est la tombe de Cyrus (+529). Elle apparaît aujourd’hui
isolée dans un terrain dénudé, mais les sources
classiques disent clairement qu’elle était environnée
de verdure, au point qu’on peut se demander si elle n’était
pas intégrée dans le parc royal, dont le jardin central
est distant d’un kilomètre.
Techniques de construction et détails architecturaux du tombeau
évoquent l’art hellénisé d’Asie mineure.
Mais dès le VIe siècle apparaît un mouvement inverse ;
ce monument a peut-être inspiré un satrape ou un personnage
important d’Asie mineure occidentale, qui a fait ériger
à Sardes un tombeau comparable à celui de Cyrus.
Pasargades • monuments • nouvelles
recherches • perspectives
Les autres constructions 5/5 L’énigmatique tour de 7 m de
côté, appelée plus tard Zendan-i Solaiman, est distante
de plus de 200 m du jardin et de 400 m de la plateforme ; tombe,
temple, temple du feu, dépôt d’archives ou des symboles
de la royauté, elle a résisté jusqu’ici à
l’interprétation ; il n’est pas sôr qu’elle
soit isolée d’autres constructions qui restent à
découvrir.
À 1 km au nord-ouest de cette tour, les deux cubes en pierre
et les traces d’une grande enceinte rectangulaire qui les protège
apparaissent encore plus isolés du reste du site central, dont
ils sont séparés par une haute colline. Ces « autels »
ont également donné lieu à bien des hypothèses
parmi lesquelles celles d’autels doubles ou bien d’un autel
du feu et d’une estrade pour le roi officiant. La religion des
Achéménides est si mal connue qu’elle autorise toutes
les interprétations, depuis un mazdéisme primitif jusqu’au
zoroastrisme véritable, tel qu’on le connaît des siècles
plus tard.
Pasargades • monuments • nouvelles
recherches • perspectives
L’organisation de la capitale de l’empire avant Darius
L’ensemble du site fait l’objet d’un nouveau programme
franco-iranien sous l’égide de l’Organisation du Patrimoine
culturel national d’Iran, soutenu par le Ministère des Affaires
Étrangères et le CNRS (France).
Pasargades apparaît au visiteur comme un site pauvre en constructions ;
on comprend que son aspect ait suscité l’hypothèse
d’un vaste camp, ce qui satisfaisait à une certaine image
de la mise en place de l’Empire achéménide, né
de l’ascension rapide d’un roi, à l’origine petit
chef de tribu, conservant son mode de vie de pasteur et de nomade.
C’est l’organisation de la capitale de l’empire avant
Darius que le nouveau programme a commencé d’étudier
en 1999. Est-ce plutôt un camp royal aménagé autour
de quelques monuments symboliques, ou bien une véritable ville
construite dont la plupart des éléments ne seraient plus
visibles ?
Pasargades • monuments • nouvelles
recherches • perspectives
Étude topographique
2/6
Même dans l’hypothèse d’un camp, celui-ci doit
avoir laissé des traces d’aménagement, marquées
en surface et surtout décelables par différentes techniques
d’investigation.
Ces traces sont étudiées à partir des observations
et relevés anciens, de l’étude topographique minutieuse,
à partir d’un nouveau relevé effectué par
l’Organisation du Patrimoine culturel iranien en 1999 (sur Autocad),
des photos aériennes anciennes (E.F. Schmidt 1935) et plus récentes
(1969 et 1989) et d’une campagne photographique par cerf-volant,
et surtout à partir de prospections géophysiques (magnétiques
surtout mais aussi électriques).
Chance particulière, Pasargades n’a pas connu d’occupations
antérieures, ni postérieures, sauf en de rares secteurs
(plateforme et tombeau de Cyrus) : la lecture des cartes de prospection
magnétique ne devrait faire apparaître que des structures
achéménides ;
Le projet porte sur une reconnaissance du site au sens large, s’étendant
au nord depuis l’origine du canal au nord de Seh Asiab et le village
de Morghab jusqu’à l’aval du Tang-i Bulaghi au sud
(environ 25 km2).
Pasargades • monuments • nouvelles
recherches • perspectives
Les opérations 3/6 Le relevé topographique s’étend
au-delà de la zone actuellement protégée, vers
le nord (enceinte polygonale), le nord-ouest dans la zone de collines
entre celle-ci et l’enceinte sacrée et au-delà, ainsi
qu’à l’est du jardin royal ; ces secteurs sont
largement cultivés aujourd’hui.
La prospection géophysique porte sur plus de 500 ha, selon une
procédure à adapter au terrain, en particulier dans les
zones cultivées. Les premiers résultats (méthode
magnétique, quelques tests de résistivité électrique)
dans la zone des palais et du Zendan, comme dans l’enceinte polygonale,
ont été très fructueux ; ils ont aussi permis
d’étalonner les réponses à partir des réponses
données par des éléments anthropiques connus.
La prospection archéologique couvre un territoire élargi
aux collines situées au nord de la zone protégée
jusqu’à Tall-i Hazrat Ya’qub. Plusieurs d’entre
elles portent à leur sommet des aménagements en pierres,
parfois modestes, non datées, qui doivent être relevées.
L’emamzadeh du Hazrat Ya’qub en particulier contient des éléments
architecturaux en pierre, travaillés comme ceux des monuments
de Pasargades même.
Pasargades • monuments • nouvelles
recherches • perspectives
Premiers résultats des prospections magnétiques 4/6 Les
constructions conservées sont en pierre, mais d’autres matériaux
étaient mis en œuvre, comme la brique crue et la terre,
comme l’ont montré les fouilles. La prospection magnétique
nécessite donc la création d’un référentiel
établi à partir des constructions connues ; elles
permettent d’étalonner les mesures, donnant ainsi une indication
sur les éventuels vestiges anciens et leur nature.
L’un des trois secteurs choisis est le jardin royal, prenant comme
référence les canaux en pierre. Les 3 ha couverts dans
le prolongement du quadrilatère (chahar bagh) au sud et hors
de celui-ci à l’est sont traversés par des alignements
orientés comme les canaux et les constructions. Il est probable
que le réseau de canaux s’étend jusqu’à
la rivière. De petites structures isolées apparaissent
également dans l’axe du Palais S. La rive gauche jusqu’à
la Porte R et un mur d’enceinte (?) n’a pas encore été
explorée. Au sud du jardin, des alignements se laissent lire
entre le Palais S et un monticule de forme quadrangulaire déjà
repéré par Herzfeld.
Pasargades • monuments • nouvelles
recherches • perspectives
5/6 Les autres secteurs
Le second secteur prospecté est à l’est de la tour
Zendan-i Sulaiman oò relevés de Herzfeld et photos aériennes
montrent un tepe de forme quadrangulaire et des alignements. Selon la
prospection, le tepe recouvre une construction de 45 m de côté
environ dont les murs extérieurs sont en pierre. Les angles sont
en forme de tours saillantes et l’intérieur est divisé
par des alignements. À l’extérieur à l’est,
la prospection confirme des longs alignements.
Le troisième secteur, à l’extérieur de la
zone archéologique protégée, couvre 1,25 ha dans
l’enceinte polygonale, qu’un sondage a identifié comme
un épais mur en briques crues. la prospection confirme l’existence
de cette masse de terre, mais ajoute à l’intérieur,
sur la pente vers le fond plat de la dépression de nombreuses
formes quadrangulaires juxtaposées. Par contraste, le fond plat,
aujourd’hui cultivé, paraît vide de tout aménagement.
Pasargades • monuments • nouvelles
recherches • perspectives
L’exploration du Tang-i Bulaghi 6/6 Toutes les eaux de la de la
plaine de Morghab convergent au sud du tombeau de Cyrus et s’engouffrent
dans un défilé, étroit au départ, qui s’élargit
après 4 kilomètres jusqu’à son débouché
12 km plus loin, près de Sivand, dans la vallée principale
qui conduit à Persépolis.
« Route royale » rupestre sur la rive droite sur
quelque 500 m en plusieurs tronçons, canal rupestre sur la rive
gauche sont représentés par des aménagements encore
bien visibles aujourd’hui. Ces travaux dans la roche, achéménides
ou bien plus récents, suscitent bien des interrogations :
faible largeur de la « voie », 1,70 m au maximum,
mais souvent 1 m, parfois réduite à 0,50 m, comme on l’a
observé en 1999 ; forts pendages du « canal »
tantôt vers l’amont, tantôt vers l’aval, nombreuses
sections inachevées. En aval de la gorge, dans la partie élargie
de la vallée, les traces de travaux rupestres sont remplacées
par une sorte de chaussée ou mur, construit en pierres, large
de 2 m, longeant la rivière et compensant les déclivités
et les accidents de terrain par une maçonnerie à peu près
horizontale.
Parties rupestres et parties construites représentent ensemble
un gros investissement de travail dont la fonction et la date restent
à déterminer. Dans une première phase, les vestiges
doivent être relevés en détail, puis assemblés
en plan et en section.
Pasargades • monuments • nouvelles
recherches • perspectives
Perspectives 1/1 Les prospections, préliminaires valident l’emploi
de la méthode magnétique qui, le cas échéant,
est complétée ou confirmée par la méthode
électrique, pour distinguer les structures en pierre de celles
en briques ou terre (tests dans le jardin royal). La superficie prospectée
(7,25 ha sur plus de 200) a valeur de test. Elle fait apparaître,
avant toute interprétation, l’existence en plusieurs secteurs
d’aménagements en pierre dont rien, ou de micro-reliefs,
n’apparaissait en surface : quelle que soit leur extension,
leur plan et leur fonction, elles démontrent déjà
la présence d’autres constructions que celles que l’on
connaissait ; elles sont parfois importantes et surtout elles remettent
certains bâtiments isolés dans un ensemble construit plus
vaste et plus complexe.
La poursuite du programme dans ces secteurs, et surtout au-delà
de la zone protégée, devrait modifier considérablement
l’image de la capitale de Cyrus.
Les mêmes méthodes appliquées dans toutes les directions
vers l’extérieur devraient atteindre des limites, c’est-à-dire
mettre en évidence un contraste entre une zone périphérique
aménagée et les environs de la ville de Pasargades qui
auraient supporté des activités agricoles, élevage
et agriculture, dont les traces seront très ténues ou
invisibles.
Pasargades — Architecture du site
1. Pasargades : présentation générale Carte
générale pour situer Pasargades.
[Pasargades 01] 2. Le site : présentation Pasargades 015
Pasargades 003 Pasargades 001 Pasargades 002 Pasargades 012 Pasargades
020 Pasargades 019 [Pasargades 02]
3. Les monuments 3.1. Présentation des monuments Pasargades 003
[Pasargades 03]
3.2. La plate-forme et l’enceinte polygonale Pasargades 007 Pasargades
008 Pasargades 009 Pasargades 01 9 [Pasargades 04]
3.3. Le jardin royal Plan jardin Stronach [à venir] Pasargades
013 Pasargades 005 Pasargades 006 [Pasargades 05]
3.4. Le tombeau de Cyrus Pasargades 001 Pasargades 002 [Pasargades 06]
3.5. Les autres constructions Pasargades 004 Pasargades 010 [Pasargades
07]
4. Les nouvelles recherches
4.1. L’organisation de la capitale de l’empire avant Darius
[Pasargades 08]
4.2. Étude topographique Pasargades 011 Pasargades 015 [Pasargades
09]
4.3. Les opérations Pasargades 015 [Pasargades 10]
4.4. Premiers résultats des prospections magnétiques :
4.4.1. Le jardin royal Pasargades 016 Pasargades 014 Pasargades 017
Plan de la partie centrale du site. Les constructions disposées
dans un jardin ou parc.
[Pasargades 11]
4.4.2. Les autres secteurs Pasargades 018 [Pasargades 12]
4.5. L’exploration de Tang-i Bulaghi Pasargades 015 Pasargades
019
[Pasargades 13]
5. Perspectives [Pasargades 14]
|